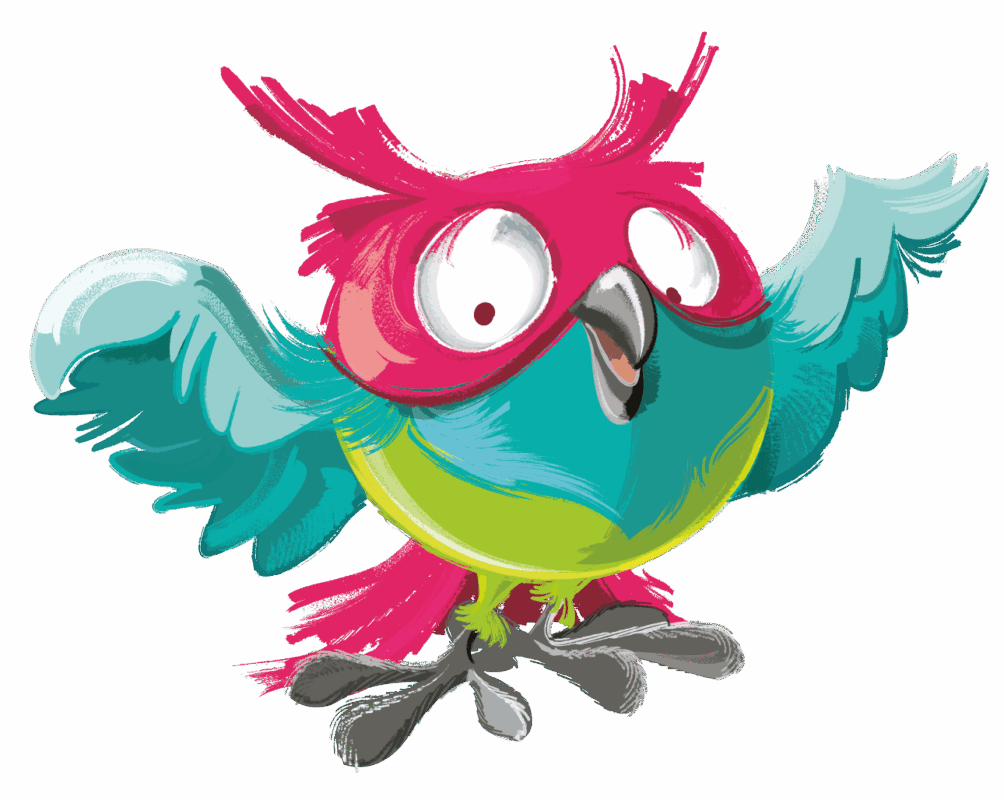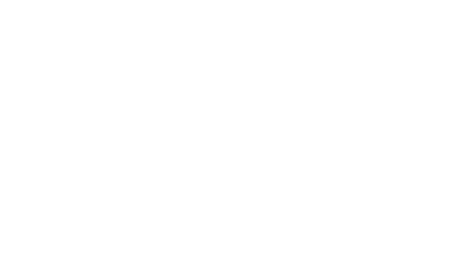1924-2024 : la reconnaissance de l’enfant sujet de droits reste un enjeu sociétal, un enjeu démocratique
Éric Delemar
Né à Fougères en 1969, Éric Delemar a consacré sa carrière à la protection de l’enfance. Formé en éducation spécialisée à Askoria et en psychocriminologie à l’Université Rennes 2, il a occupé divers postes en Ille-et-Vilaine, comme éducateur, chef de service puis directeur adjoint du Centre départemental de l’enfance. Depuis 2020, il est Défenseur des enfants et Adjoint de la Défenseure des droits, premier homme à exercer cette fonction au national. Membre du réseau européen des Défenseurs des droits de l’enfant, il œuvre pour promouvoir les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant et supervise chaque année des milliers de dossiers, réclamations et instructions concernant des atteintes aux droits des enfants.
En 1924, la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève[1], un texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l’existence de droits spécifiques aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard.
Au début des années 1920 et alors que le monde vient de vivre l’horreur de la Première Guerre mondiale qui a fait plus de 20 millions de morts et autant de blessés, plus d’un million d’orphelins vont subir famines et maladies. La Société des Nations déclare alors, dans la Déclaration de 1924, que « l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur », en les protégeant des guerres, en luttant contre la pauvreté des enfants et contre toutes les violences qui leur sont faites.
Cette Déclaration a été influencée par les travaux de Janusz Korczak[2], qui fut un témoin très impacté par les conséquences des guerres, des conflits tsaristes et des traumatismes de la Première Guerre mondiale. Il est alors convaincu que l’éducation à la non-violence, des adultes envers les enfants, mais également entre les enfants eux-mêmes, est un enjeu fondamental pour nos démocraties, un enjeu de civilisation.
Suite à la Déclaration de Genève, une seconde Déclaration dédiée aux droits de l’enfant est adoptée en 1959 par l’Assemblée générale des Nations Unies qui déclare que « l’enfant doit […] se voir accorder des possibilités et des facilités […] afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité » [3].
Trente ans plus tard, le 20 novembre 1989, un texte plus complet est consacré par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Ce texte a été soumis aux Nations Unies dix ans auparavant à l’initiative de la Pologne, le pays de Janusz Korczak, dès lors qu’aucune des deux Déclarations précédentes n’était contraignante et n’englobait l’ensemble des droits de l’enfant. La CIDE, texte à vocation universelle et contraignant pour les États l’ayant ratifiée, comprend 54 articles dont celui qui porte sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et qui fait écho à ce que Janusz Korczak appelait dans ses écrits « le droit de l’enfant au respect »[4]. L’article 3.1 de la CIDE proclame ainsi :
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale[5].
La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est définie comme la recherche du meilleur intérêt de l’enfant[6] et vise à assurer la jouissance effective de tous ses droits ainsi que le respect de son développement global, que ce soit sur le plan physique, mental, spirituel, moral, psychologique ou social, à la lumière de sa vulnérabilité particulière. L’intérêt supérieur de l’enfant est donc à la fois un objectif, une ligne de conduite, une notion guide, un principe procédural, une règle d’interprétation, un droit subjectif qui doit éclairer, habiter et irriguer toutes les normes, procédures et décisions concernant chaque enfant[7].
Outre la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, la CIDE déclare que l’enfant devient dès sa naissance détenteur de l’ensemble des droits de l’Homme dans une vision universelle, indivisible, indissociable et interdépendante, et que petit être humain ne veut pas dire petit droit.
Nous fêtons cette année [2024] le centenaire de la Déclaration de Genève, et force est de constater que si, en théorie, des progrès historiques ont été consacrés, spécialement incarnés par la CIDE, la lutte pour la protection effective des enfants dans les conflits armés, pour lutter contre toutes les formes de violence, pour éradiquer la pauvreté des enfants, reste un enjeu de civilisation à travers le monde.
Les enfants et adolescents grandissent en effet dans un monde aux crises et bouleversements multiples : réchauffement climatique, terrorisme, peur de la pauvreté et du déclassement, guerres partout dans le monde et aujourd’hui en Europe. A l’heure des réseaux sociaux et de l’information en continu, notre monde particulièrement anxiogène a des répercussions sur leur santé mentale et nécessite plus que jamais des politiques de prévention et de protection à la hauteur de ces enjeux.
Pour que les droits de l’enfant deviennent un sujet politique il faut les rendre publics. C’est ce que notre société a commencé à faire ces dernières années et nous n’avons d’ailleurs jamais autant entendu parler en France dans les médias des violences faites aux enfants, de leurs conséquences sur le développement des enfants et de leur nécessaire protection. Il nous incombe, en tant qu’adultes, une très forte responsabilité, à savoir faire en sorte que les enfants victimes n’aient plus besoin d’attendre d’être des anciens enfants pour être enfin écoutés, enfin entendus[8].
Accueillir la parole d’un enfant et d’un adolescent, c’est lui proposer une écoute et une présence bienveillante, fiable, rassurante et sécurisée aussi longtemps que nécessaire. Un accompagnement de bonne qualité et respectueux du temps nécessaire à l’enfant pour se confier et dénoncer parfois des faits très lourds de conséquence pour son devenir. L’enfant a besoin d’un adulte qui prendra le temps de l’écouter, quelqu’un qui le comprendra, qui réfléchit et ressent de l’empathie pour lui, qui lui propose des paroles et entrevoit des relais ou solutions possibles.
Il nous faut donner le courage aux enfants de prendre la parole et ne pas attendre qu’ils passent à l’acte, envers eux-mêmes ou envers les autres, pour enfin se sentir obligés de les écouter. C’est un processus pédagogique qui devrait influer en permanence l’action des adultes et de tous les professionnels de l’enfance. Pour cela il faut considérer l’enfant comme sujet de droits, sujet de prise en compte, plutôt que simple objet de prise en charge.
En France, dans ce monde anxiogène, les discours sur l’absence d’autorité se multiplient. Des partisans d’une éducation traditionnelle remettent en cause la loi de juillet 2019 surnommée « loi anti-fessée ». Cette loi a modifié le Code civil en rappelant que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». À l’époque, une partie de l’opinion publique avait affiché sa réticence, inquiète d’un recul de l’autorité et des parlementaires s’étaient opposés au texte, estimant que l’État n’avait pas à s’immiscer dans l’éducation des enfants.
La CIDE reste un texte éminemment moderne, qui vient reconnaitre l’enfant comme un alter ego, un égal, un autre soi – mais un autre que soi ; différent, sans être réductible à sa différence[9]. Pourquoi le fait qu’un adulte puisse mesurer 50 centimètres de plus et peser 50 kilos de plus, lui donnerait-il le droit d’utiliser la force pour contraindre ? Si une personnalité se rendait dans les médias pour prôner la violence envers les personnes âgées ou envers les personnes en situation de handicap, des excuses seraient a minima exigées. De même, nous nous offusquerions, à juste titre, de la violence commise envers les animaux. Mais notre société accepte encore que l’on puisse aller dire à la télé qu’on peut frapper nos enfants pour les éduquer. C’est là une ignorance qui empêche des progrès humains pourtant fondateurs de notre humanité et de notre solidarité.
Ce retour de l’autorité, par la peur et la violence, plutôt que par la légitimité, la transmission des savoirs dans des postures bienveillantes est pourtant totalement contradictoire avec les engagements internationaux des États. Les travaux de grands pédagogues, tel Janusz Korczak, comme l’apport des neurosciences nous invitent à une révolution éducative et pédagogique, car nous savons qu’un enfant élevé avec bienveillance, empathie, que l’on aide à se connecter à ses émotions, à les exprimer, va devenir lui-même empathique, sociable et ne développera pas des comportements agressifs et antisociaux.
Preuve que la pensée de Janus Korczak reste bien vivante aujourd’hui et que sa réflexion sur la place accordée à l’enfant dans notre société continue à être source de débats. Si beaucoup reste à faire pour préserver les enfants, où qu’ils naissent, des effets de la guerre, de la pauvreté, de la maltraitance familiale ou institutionnelle et de tous les autres facteurs de souffrance, plus personne aujourd’hui ne peut nier le fait que l’enfant est un sujet de droits.
Footnotes
[1] Société des Nations, Déclaration de Genève des droits de l’enfant (1924), https://www.humanium.org/fr/texte-integral-declaration-de-geneve/#:~:text=L’enfant%20qui%20a%20faim,doivent%20être%20recueillis%20et%20secourus.
[2] Pour plus de détails sur la vie de Korczak, voir Dominique Prusak et Anna Szmuc, « Jonas Korczak : La Parole est aux enfants, » podcast, Radio France, 5 août 2017,https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-heure-du-documentaire/janusz-korczak-la-parole-est-aux-enfants-5550216 et Louise Tourret, animatrice, Avoir raison avec…, podcast, épisode 4, “Janusz Korczak, l’invention du droit des enfants”, Radio France, 8 août 2024, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec/janusz-korzcak-l-invention-du-droit-des-enfants-8142445.
[3] AG Rés. 1386(XIV), Déclaration des Droits de l’Enfant (20 novembre 1959), https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/143/32/pdf/nr014332.pdf.
[4] Janusz Korczak, Le droit de l’enfant au respect (Faber, 2009).
[5] AG Rés 40/25, Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989), art. 3 ¶1.
[6] Le « meilleur » intérêt de l’enfant plutôt que l’intérêt « supérieur » de l’enfant aurait d’ailleurs été une traduction plus heureuse de l’expression anglaise « the best interests of the child ».
[7] Cf. Comité des Droits de l’Enfant, Observation générale n° 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale UN doc. CRC/C/GC/14, art.3 ¶ 1.
[8] Sur le droit au respect de l’opinion de l’enfant, cf. Comité des Droits de l’Enfant, Observation générale n° 12 sur Le droit de l’enfant d’être entendu, UN doc. CRC/C/GC/12.
[9] Dans le même sens, cf. Anne-Catherine Rasson, La vulnérabilité de l’enfant et la justice constitutionnelle : de l’intérêt de l’enfant aux droits de l’enfant (Larcier, à paraître).