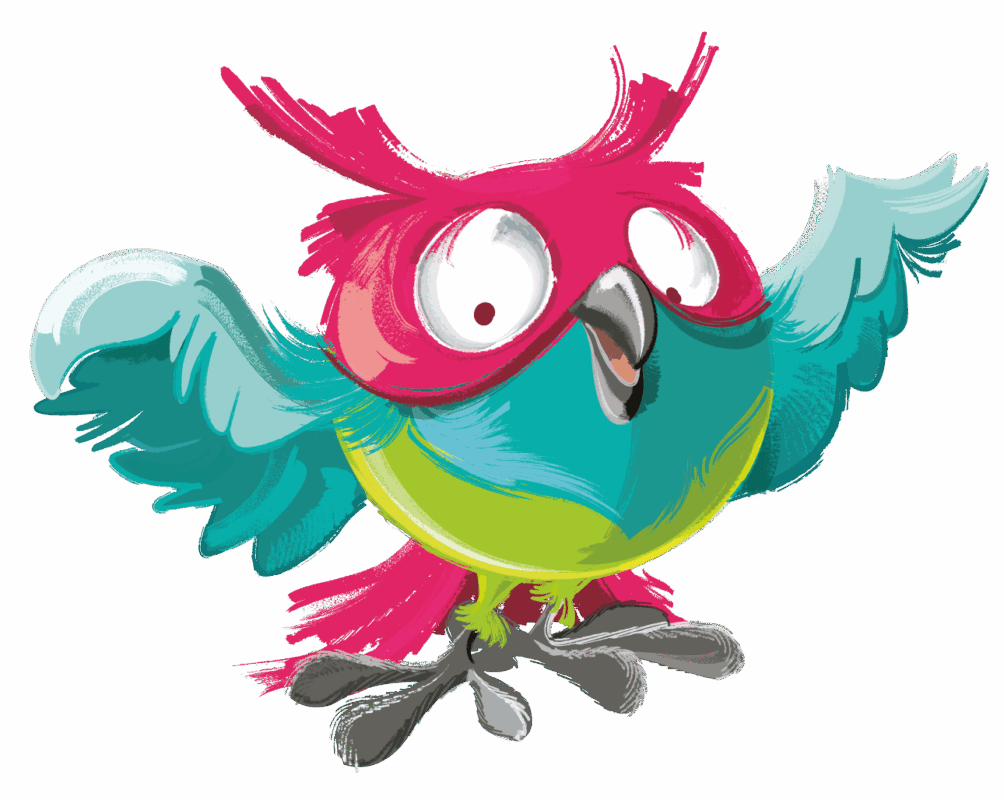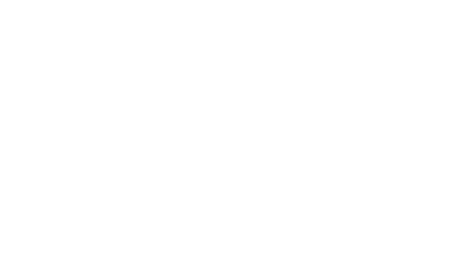Garantir les droits des enfants au nom de la justice climatique
Natasha Lepage & Julien Wald
Natasha Lepage
Natasha Lepage est une militante luxembourgeoise pour la justice climatique et les droits de l’Homme. Elle a commencé à militer très jeune. En 2019, après avoir vu des milliers de jeunes descendre dans la rue pour exiger une action climatique, elle a rejoint Fridays For Future, le mouvement mondial de la jeunesse pour le climat qui au Luxembourg s’appelle Youth for Climate.
Depuis elle milite activement pour la protection du climat et le renforcement du pouvoir de décision des jeunes, notamment dans l’élaboration des politiques. En 2023, Natasha a représenté les jeunes du Luxembourg à la 78e session de l’Assemblée Générale de l’ONU en tant que Déléguée de la Jeunesse des Nations Unies. En 2024, elle est devenue la première Déléguée de la Jeunesse pour le Climat du Luxembourg, travaillant en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et participant en tant que membre de la délégation nationale à la 29e Conférence des États signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29).
Outre son engagement international, Natasha est aussi activement impliquée dans la promotion des droits de l’enfant au Luxembourg en tant que jeune conseillère de l’OKAJU.
Julien Wald
Julien Wald est un militant pour la jeunesse originaire du Luxembourg, engagé dans la défense du climat et des droits de l’Homme. Il a représenté les jeunes du Luxembourg en tant que Délégué de la Jeunesse des Nations Unies (2023-2024) à la 78e session de l’Assemblée Générale de l’ONU. Siégeant alors à la Troisième Commission, il a défendu les droits de l’Homme et le développement durable, en mettant l’accent sur les droits de l’enfant et les effets persistants du changement climatique.
En tant que jeune conseiller de l’OKAJU, il a contribué à l’élaboration de recommandations sur les droits de l’enfant, la santé mentale des jeunes et leur intégration dans les mécanismes de prise de décision. Il a commencé à militer pour le climat au sein de Youth for Climate Luxembourg en 2019, en organisant des manifestations et en collaborant avec la société civile pour promouvoir la justice climatique. Il a aussi engagé le dialogue sur des revendications politiques avec des décideurs, à l’échelle nationale et européenne.
Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. La crise climatique n’est pas seulement un enjeu environnemental, c’est aussi une violation directe des droits de l’enfant. Du droit à l’éducation au droit à la santé, presque tous les aspects du bien-être des enfants sont menacés par le changement climatique. Bien qu’ils y contribuent le moins, les enfants sont les plus affectés par ses retombées.
S’ils sont les plus vulnérables, les enfants et les jeunes sont toutefois aussi à l’avant-garde de la lutte pour la justice climatique. A travers des mouvements comme Fridays For Future, les jeunes militants secouent l’inaction politique et exigent des décisions urgentes pour le climat.
Mais le militantisme à lui seul ne suffit pas. La lutte contre le changement climatique nécessite une action coordonnée des gouvernements nationaux et des institutions internationales afin d’établir et de renforcer des cadres juridiques. Ces derniers doivent permettre un changement urgent et efficace, donnant la priorité aux enfants et à leurs droits dans les politiques climatiques.
Reconnaître l’impact sur les enfants et les jeunes du changement climatique et des crises mondiales qui lui sont liées est essentiel pour protéger leurs droits. L’éducation au climat peut être considérée comme un moyen de combler le fossé de la polarisation climatique chez les enfants. En outre, la participation significative des jeunes à la prise de décision est importante pour responsabiliser les enfants et faire en sorte que leur voix soit entendue dans les décisions politiques et juridiques.
En abordant ces questions émergentes, nous ouvrons la voie à la justice climatique et à la solidarité intergénérationnelle.
Le cadre juridique des droits de l’enfant et de l’environnement
Il existe un certain nombre d’instruments qui créent un cadre juridique pour les droits de l’enfant et pour l’environnement. Il s’agit notamment de la législation sur les droits de l’Homme, de celle sur l’environnement ainsi que des normes établies par des organismes internationaux, régionaux et nationaux.
Le droit international relatif aux droits de l’Homme
Le changement climatique n’est pas explicitement mentionné dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Dans les observations générales il est néanmoins noté que la crise climatique a un impact sur les droits de l’enfant. Le Luxembourg a ratifié la CIDE en 1994. Le préambule de la CIDE mentionne l’importance de la protection de l’environnement naturel pour le développement et le bien-être des enfants. En outre, il établit que plusieurs droits fondamentaux sont liés à l’environnement naturel, en particulier le droit à la santé (article 24(2)(c)) et le droit à l’éducation (article 29(1)(e)).
En 2023, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a reconnu dans son Observation générale n° 26 que la crise climatique compromet gravement la pleine jouissance des droits de l’enfant. Les États ont l’obligation légale de prendre des mesures urgentes pour protéger les jeunes de l’impact environnemental. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de toutes les politiques climatiques[1]. Les gouvernements évaluent l’impact du changement climatique sur les enfants. Les États doivent prendre des mesures climatiques plus ambitieuses et plus efficaces afin de protéger les droits des enfants[2]. L’inaction climatique peut constituer une violation de ces droits.
Obligations en matière de climat
En signant l’Accord de Paris (2015), les États se sont engagés à atténuer le changement climatique et maintenir les températures moyennes mondiales bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, idéalement à 1,5°C[3]. Le préambule reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. En outre, les États doivent tenir compte des groupes vulnérables lorsqu’ils prennent des mesures pour s’adapter au changement climatique ou pour en atténuer les effets du. Pour remplir leurs obligations, les États doivent par conséquent protéger explicitement les droits de l’enfant. Le Luxembourg a l’obligation de protéger les droits de l’enfant dans toute la mesure du possible[4].
La réduction des émissions devrait de surcroît être une priorité afin de permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits et leur éviter de subir des dommages irréversibles.
La CIDE et l’Accord de Paris constituent une base pour protéger les droits de l’enfant dans le contexte du changement climatique. Toutefois, ces cadres juridiques sont encore très fragmentaires et insuffisamment appliqués.
Ils ont néanmoins été utilisés par des enfants et des jeunes comme base juridique pour des litiges stratégiques. Les gouvernements ont l’obligation légale de prendre des mesures concrètes pour faire respecter ces droits. L’inaction actuelle en matière de changement climatique a un impact négatif sur le bien-être et le développement des enfants.
La crise climatique, une polycrise
L’indice de risque climatique pour les enfants de l’UNICEF montre qu’un milliard d’enfants vivent dans des pays extrêmement menacés par le changement climatique[5]. La crise climatique a un impact dévastateur sur la vie, la santé, l’éducation et le bien-être des enfants dans le monde entier. Qu’il s’agisse de risques sanitaires accrus ou d’insécurité alimentaire croissante, les risques auxquels les enfants sont confrontés sont disproportionnés.
Dans le monde entier, les enfants subissent – et continueront de subir – le stress, les risques et les bouleversements causés par le changement climatique. La crise climatique touche les enfants du monde entier, en particulier ceux des pays du Sud où ses conséquences sont les plus graves.
L’exposition répétée aux risques climatiques et environnementaux porte atteinte aux droits : droit à la santé, droit à une alimentation et à une eau suffisantes, droit à l’éducation et droit à la vie. Il est évident que la crise climatique n’est pas un enjeu isolé, mais qu’elle est au contraire étroitement liée à d’autres défis mondiaux, tels que les guerres, l’instabilité politique et économique, la sécurité de l’eau, la crise énergétique et les pandémies. C’est ce que les spécialistes appellent une polycrise[6]. Ce concept reconnaît que les multiples crises mondiales sont interconnectées, qu’elles se renforcent et s’amplifient les unes les autres, et que les enfants sont au centre de ces crises, dont ils subissent souvent les conséquences les plus graves.
Comprendre le changement climatique à travers le prisme d’une telle polycrise met en évidence la nécessité de solutions systémiques, intergénérationnelles et fondées sur les droits. Elle souligne le besoin urgent d’économies résilientes au changement climatique, de sensibilisation et d’éducation au climat, de systèmes de santé plus solides et d’un cadre garantissant que l’action climatique est prise en compte à tous les niveaux de l’élaboration des politiques.
En outre, la crise climatique et les problèmes mondiaux qui lui sont liés peuvent à long terme avoir des répercussions importantes sur la santé mentale des enfants et susciter une anxiété climatique et une éco-anxiété[7]. L’anxiété est une émotion que certains enfants éprouvent parce qu’ils se sentent dépassés par la complexité des défis mondiaux et par l’absence de solutions claires pour les relever. Les enfants sont confrontés à un stress physiologique supplémentaire, accompagné d’un sentiment de désespoir et de frustration causés par l’inaction politique face au changement climatique. Pour les jeunes, la polycrise aggrave les problèmes de santé mentale, ce qui se traduit par une éco-anxiété croissante et un stress supplémentaire. Ces facteurs de stress violent le droit de l’enfant au meilleur état de santé possible.
Dans ce contexte, seules une éducation et une sensibilisation précoces axées sur le climat peuvent préparer les enfants à faire face à ces défis mondiaux.
L’éducation au climat comme moyen de combler le fossé de la polarisation climatique
L’éducation est un outil essentiel pour faire face à la crise climatique, mais de nombreux programmes scolaires n’abordent pas suffisamment la science du climat, la justice environnementale et les impacts sociaux du réchauffement climatique. En l’absence d’une connaissance globale du climat, les enfants et les jeunes ne disposent pas des outils nécessaires pour comprendre, s’engager et répondre aux défis actuels du changement climatique.
La manière dont le changement climatique est enseigné est très importante. Lors de récentes consultations avec des enfants et des jeunes au Luxembourg, nombre d’entre eux ont confié ressentir une fatigue climatique et un sentiment de désespoir et de frustration, pour avoir été exposés de manière répétée aux effets alarmants du changement climatique sans perspective de solution réalisable. Cela alimente l’éco-anxiété, un phénomène croissant chez les enfants et les jeunes. À l’inverse, l’absence d’éducation climatique adéquate peut conduire au déni, à l’apathie ou à la désinformation. Afin de surmonter la polarisation et le renoncement, il est nécessaire de mettre en place une éducation climatique inclusive, responsabilisante et systématique.
En outre, l’éducation au climat devrait être interdisciplinaire et intégrer les connaissances venant notamment des sciences sociales, des sciences naturelles et de l’éducation civique. Au-delà de la présentation des faits, l’éducation devrait enseigner aux enfants et aux jeunes comment analyser et évaluer les défis liés au changement climatique.
Une éducation climatique de qualité renforcera le droit des enfants à l’information et à la participation en leur permettant d’agir en connaissance de cause et de s’engager dans le débat public. Elle leur fournira aussi les outils pour mieux comprendre la triple crise planétaire que constituent le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.
Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a par ailleurs déclaré qu’à l’approche de l’âge adulte les adolescents doivent avoir accès à une éducation adaptée leur permettant de relever les défis locaux et mondiaux, y compris le changement climatique et la dégradation de l’environnement[8].
Il est essentiel de reconnaître le droit à l’éducation comme le moyen le plus efficace de combler le fossé de la polarisation climatique et de passer de l’inaction à l’action climatique.
Le militantisme climatique de la jeunesse
Les enfants sont en première ligne dans la lutte pour la justice environnementale. Des petites manifestations locales à la mobilisation mondiale, les enfants et les jeunes militants ont multiplié les actions pour sensibiliser l’opinion, interpeller les pouvoirs publics et exiger une action climatique urgente.
Le mouvement Fridays For Future (FFF) a commencé en août 2018 avec une seule lycéenne assise devant le parlement suédois tous les vendredis. Greta Thunberg n’avait que 15 ans lorsqu’elle a décidé de lancer sa « Skolstrejk för klimatet » (grève scolaire pour le climat). Ce qui n’était au départ qu’une action individuelle s’est rapidement transformé en un mouvement mondial. En mars 2019, des jeunes de plus de 125 pays ont organisé la première grève mondiale pour le climat, qui a réuni plus de 1,6 million de participants[9]. Pour la première fois dans l’histoire, des enfants et des jeunes s’étaient mobilisés à l’échelle internationale pour réclamer la justice climatique.
Au Luxembourg, plus de 15 000 étudiants ont participé à la première grève pour le climat en 2019. Dans le cadre de ce mouvement mondial, les jeunes militants se sont battus pour que leurs gouvernements tiennent les engagements qu’ils avaient pris en signant l’Accord de Paris. Au cœur de cette mobilisation se trouvait l’appel à une justice climatique internationale et intergénérationnelle, reconnaissant que la crise climatique affecte de manière disproportionnée les jeunes et les générations futures.
Le combat pour la justice climatique n’est pas qu’un mouvement de jeunesse ; il nécessite une collaboration intergénérationnelle. Les enfants et les jeunes doivent s’engager dans un dialogue constructif avec les décideurs politiques. Les adolescents en particulier devraient être reconnus comme des agents du changement qui apportent créativité, passion et solutions innovantes aux défis posés par le changement climatique[10].
La lutte contre la crise climatique est un enjeu crucial pour les générations actuelles et futures. Par conséquent, pour parvenir à une véritable justice climatique, le changement doit être soutenu par une action politique et des efforts intergénérationnels afin de léguer une planète vivable aux générations futures.
Outre la mobilisation politique, les jeunes se sont tournés vers les tribunaux pour faire avancer les droits de l’enfant dans le contexte de l’action climatique. Ces litiges stratégiques peut être considérée comme une forme de militantisme. Ils visent à remettre en question l’inaction politique, à élargir les cadres juridiques existants et à faire comprendre que le changement climatique est fondamentalement une question de droits de l’Homme.
Défenseurs des droits de l’enfant
Partout dans le monde, des enfants défendent leurs propres droits. Dans l’affaire Sacchi et al. c. Argentine et autres (2021), 16 enfants ont déposé une plainte devant le Comité des droits de l’enfant. Ils ont fait valoir que plusieurs États n’avaient pas pris les mesures adéquates pour lutter contre le changement climatique, violant ainsi plusieurs droits de l’enfant énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant. Bien que l’affaire ait été classée sans suite pour des raisons de procédure, le Comité a reconnu que les États peuvent porter une responsabilité extraterritoriale pour les émissions de gaz à effet de serre et que les dommages environnementaux transfrontaliers peuvent donner lieu à des responsabilités étatiques.
Dans l’affaire Duarte Agostinho c. Portugal et autres (2024), un groupe de six jeunes citoyens portugais a allégué de la même manière que le Portugal et 32 autres États avaient violé plusieurs droits de l’Homme énoncés dans la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), en raison des impacts présents et futurs du changement climatique. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a, tout comme le Comité des droits de l’enfant, reconnu la nature existentielle du changement climatique et le fait que les États ont endossé des obligations internationales en matière de climat. Elle a toutefois déclaré l’affaire irrecevable pour des raisons de procédure, les requérants n’ayant pas épuisé toutes les solutions au niveau national. Contrairement au Comité des droits de l’enfant, la Cour européenne des droits de l’Homme a refusé d’élargir la compétence extraterritoriale de la CEDH.
Bien qu’aucune de ces deux affaires n’ait abouti, elles ont contribué à définir les limites et contraintes juridiques actuelles que les enfants devront prendre en compte dans les futurs litiges climatiques. L’arrêt rendu avec succès dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (2024), devant la Cour européenne des droits de l’Homme, constitue ainsi un précédent précieux pour les défenseurs des droits de l’enfant qui déposeront des plaintes à l’avenir. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a clarifié les critères de recevabilité dans les affaires liées au climat : les requérants individuels doivent démontrer une « forte intensité d’exposition » aux conséquences négatives et un « besoin urgent » de protection en raison de l’insuffisance des mesures prises par l’État[11]. Les associations peuvent quant à elles être habilitées à intenter une action si elles sont légalement constituées, poursuivent un objectif de protection des droits de l’Homme et sont réellement qualifiées et représentatives des personnes concernées[12].
Cet arrêt montre l’avantage procédural qu’il y a à s’appuyer sur des associations pour introduire des plaintes liées au climat devant les tribunaux des droits de l’Homme. Cela pourrait constituer une voie potentielle pour les futurs défenseurs des droits de l’enfant.
Aller de l’avant
La lutte contre le changement climatique ne se limite pas à l’environnement, elle a aussi pour but de renforcer la solidarité et la justice internationales, et de garantir que les droits de l’enfant soient au cœur de la politique climatique.
Les cadres juridiques jouent un rôle déterminant dans la protection des enfants contre les effets du changement climatique. Sans application ni action significative, ces droits restent néanmoins théoriques[13]. Nous devons veiller à ce que les politiques environnementales tiennent compte des besoins des enfants, en reconnaissant l’impact disproportionné que le changement climatique a sur eux et en faisant de leurs besoins une priorité dans toutes les décisions liées au climat. Cela inclut une implication réelle des enfants et des jeunes dans les négociations et les prises de décision sur le climat aux niveaux national, régional et international. L’action climatique ne peut être réellement efficace qu’en étant intergénérationnelle, qu’en encourageant la collaboration entre les jeunes et les décideurs politiques pour élaborer des solutions efficaces et inclusives. L’éducation doit être une priorité afin de garantir l’engagement des générations futures et de reconnaître l’importance de la connaissance du climat pour combler le fossé de la polarisation climatique. L’accès à une éducation de qualité est un outil primordial pour garantir la justice climatique et sociale et protéger les droits des enfants.
Les gouvernements doivent reconnaître l’interconnexion des crises mondiales et garantir que les droits de l’enfant sont au centre de toutes leurs politiques.
Comme l’ont montré les récents litiges relatifs au climat portés devant les instances internationales des droits de l’Homme, les défenseurs des droits de l’enfant disposent d’une base juridique solide pour obtenir gain de cause. Nous devons utiliser tous les moyens existants pour étendre la reconnaissance du changement climatique en tant qu’impératif lié aux droits de l’Homme.
La voix des enfants et des jeunes tonne dans les rues, mais elle doit également se faire entendre dans les tribunaux, les parlements et les négociations mondiales sur le climat. Il est temps de s’attaquer aux causes profondes du changement climatique avant qu’il ne soit trop tard et que les enfants n’en subissent les pires conséquences. Promouvoir la sensibilisation sociale le plus tôt possible et fournir une éducation climatique de qualité sont des outils essentiels pour permettre à une nouvelle génération de comprendre les défis qui nous attendent et se battre pour notre climat.
Footnotes
[1] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement, en mettant l’accent sur le changement climatique, UN doc. CRC/C/GC/26, § 16.
[2] CRC/C/GC/26, § 8.
[3] Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Accord de Paris, art. 1, § 2, ¶ a.
[4] CCNUCC, Accord de Paris, art. 4.
[5] Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), La crise climatique est une crise des droits de l’enfant : Présentation de l’Indice des risques climatiques pour les enfants (UNICEF Division de la Communication, 2021).
[6] Jani Siirilä et Arto O. Salonen, ‘Towards a sustainable future in the age of polycrisis’, Frontiers in Sustainable Development 5 (2024) : https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1436740.
[7] Caroline Hickman et al., ‘Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey,’ The Lancet Planetary Health 5, n° 12 (2021) : 863-873.
[8] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale 20 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, UN doc. CRC/GC/20, §12.
[9] BBC, ‘School strike for climate: Protests staged around the world’, BBC, 24 mai 2019, https://www.bbc.com/news/world-48392551.
[10] CRC/GC/20, § 2.
[11] Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC] App n° 53600/20 (CEDH, 9 avril 2024),§ 487.
[12] App n° 53600/20 (CEDH, 9 avril 2024), § 502.
[13] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant – Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, UN doc. A/HRC/35/13.