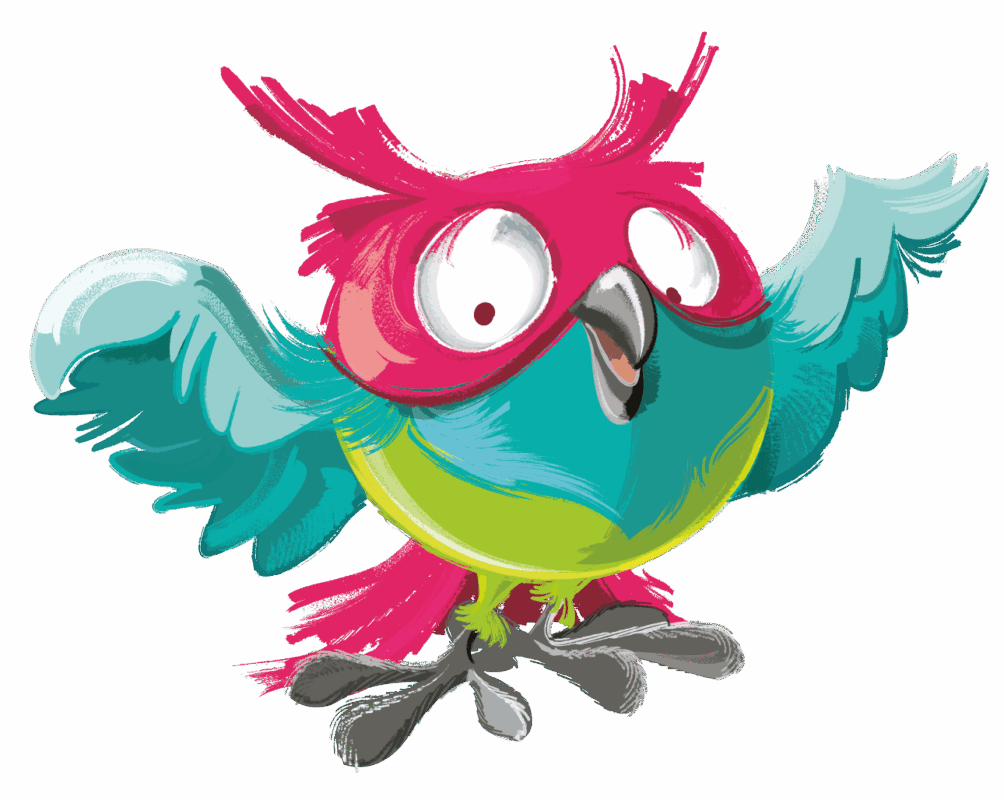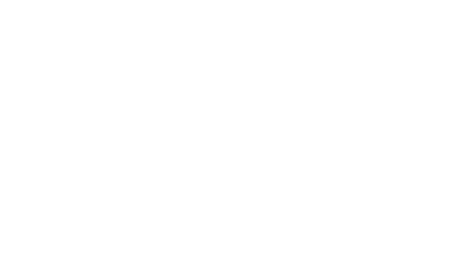Janusz Korczak : la Déclaration de Genève en question
Eliza Smierzchalska
Née en 1971 à Gdansk, en Pologne, Eliza Smierzchalska vit à Bruxelles. Artiste autodidacte, elle travaille dans le domaine du cinéma d’auteur et de l’illustration. Passionnée par la figure et l’œuvre de Janusz Korczak, elle travaille actuellement à une biographie graphique de ce pédagogue et écrivain polonais. Elle a traduit et illustré son livre-culte, Le roi Mathias Ier.
Aborder les droits de l’enfant dans la perspective de Janusz Korczak / Henryk Goldszmit demande de se défaire d’un certain nombre d’idées reçues, de clichés et d’erreurs biographiques, qui découlent d’une part de la destruction de la ville de Varsovie et de la restriction des libertés des chercheurs pendant la période communiste et d’autre part du contexte émotionnel particulièrement difficile lié à sa mort à Treblinka, qui a fait de l’homme un héros et un martyr. La première biographie qui lui fut consacrée, écrite par Hanna Mortkowicz-Olczakowa[1], parut en 1949. Mais à peine publié, son ouvrage Janusz Korczak fut retiré des librairies : « Les fonctionnaires en charge de l’édition et de l’éducation nationale ont irrévocablement qualifié les livres de Korczak de nuisibles et d’inutiles. […] Mon livre qui parlait de la vie de Korczak, et qui a été publié en 1949, a eu droit au même sort que toute son œuvre[2] », explique Hanna Mortkowicz-Olczakowa en 1956, dans son article de presse « À propos de Janusz », quand l’évolution du contexte politique a permis une reparution de son livre. Dès la préface, elle attire l’attention sur les pièges tendus par la légende tissée autour de Janusz Korczak le jour même de sa dernière marche vers l’Umschlagplatz[3], l’étoffe du héros et du martyr ayant eu tendance à occulter l’homme :
Le conflit entre la véritable vie d’un être humain et la légende est dangereux. Surtout quand la légende est aussi imposante que celle de la mort de Janusz Korczak et de ses deux cents enfants… […] Le feu qui a ravagé sa ville et son entourage a englouti presque tous les exemplaires de ses livres et la totalité de l’immense documentation qu’il a récoltée pendant des années. Il ne subsiste plus que quelques livres et quelques rares amis et compagnons de travail.
Ces livres et ces personnes peuvent aujourd’hui entreprendre un dialogue difficile et exigeant avec la légende. Et ils ont le devoir de le faire[4].
Grâce au colossal travail éditorial initié en 1977 par Hanna Kirchner, Alexander Lewin et Stefan Wołoszyn, on peut désormais nuancer les propos de Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Leur collection commentée des Œuvres de Korczak, dont le premier tome a été publié en 1992, se compose à ce jour de quinze tomes en vingt volumes et sa publication n’est pas encore achevée[5]. La documentation réunie dans le tome 13, publié en 2017 sous le titre La théorie et la pratique. Articles pédagogiques (1919-1939)[6], apporte un nouvel éclairage sur la manière dont Janusz Korczak / Henryk Goldszmit appréhendait le concept de protection de l’enfance et celui de droits de l’enfant. Enfin, avec la parution en 2023 du livre Un autre visage de Korczak, de Bożena Wojnowska, qui structure et synthétise une importante partie des commentaires et des recherches ayant accompagné l’édition des Œuvres, nous sommes enfin en mesure de nous figurer avec plus de justesse ce que Korczak entendait par droits de l’enfant.
Un terreau socio-culturel propice
Un autre visage de Korczak[7] dresse une image claire du milieu dans lequel Janusz Korczak a évolué, alors que son identité complexe a subi des distorsions au fil des différentes biographies qui lui ont été consacrées, faisant de lui tour à tour un Polonais ou un Juif plus ou moins assimilé. L’une des thèses les plus importantes de l’ouvrage de Bożena Wojnowska consiste à mettre en lumière « les parallèles entre le modèle culturel de l’intellectuel polonais, modèle que Korczak vénérait depuis sa jeunesse, et le modèle culturel juif réformateur, fondé sur les aspirations émancipatrices de la Haskala[8] ». Prendre en compte cette double influence culturelle permet « de situer la thématique de “l’enfant” plus précisément dans le contexte des mouvements d’émancipation de l’époque et en particulier des aspirations auto-émancipatrices des Juifs, qui revendiquaient le droit à l’autodétermination[9] ».
Henryk Goldszmit naît vers 1878[10] à Varsovie, dans une famille juive progressiste liée au mouvement de la Haskala, et dans un climat d’oppression sociale dû à l’occupation de cette partie de la Pologne par l’Empire russe. « Le mouvement de la Haskala s’est fixé pour objectifs la modernisation interne de la communauté juive et la revalorisation de sa place dans la société et la culture des pays d’implantation, préconisant la réforme du judaïsme et diffusant un savoir laïque. […] Les Goldszmit rejoignirent les rangs de l’intelligentsia juive de Varsovie, de plus en plus nombreuse à adhérer à l’expérience de la Haskala qui consistait à reconstruire leur propre communauté, mais dans un pays politiquement asservi et fortement marqué par les divisions sociétales »[11].
C’est ainsi qu’Henryk Goldszmit et sa sœur Anna reçoivent une éducation laïque en plusieurs langues[12], dont le yiddish est exclu en raison de la volonté de leurs parents de rompre avec le judaïsme traditionnel. Bien que laïque, cette éducation est néanmoins imprégnée des valeurs juives telles que l’amour du prochain, l’engagement à porter secours aux pauvres et aux orphelins, le sens de la responsabilité individuelle et collective dans la réparation du monde. La Haskala prône le droit à l’autodétermination et insiste sur l’importance de l’éducation comme vecteur du changement : « L’idée de la mission des intellectuels auprès du large cercle des “frères non éclairés” a pris forme : il fallait leur apporter l’éducation, leur inculquer la citoyenneté, éliminer les superstitions religieuses et les éduquer à la tolérance »[13]. Józef et Jakub Goldszmit, le père et l’oncle de Henryk, publient en polonais des biographies de Juifs célèbres ainsi que des articles destinés avant tout à la communauté juive mais aussi aux Polonais curieux de mieux connaître leurs voisins[14]. Aux propositions d’assimilation faites par le milieu positiviste polonais, les Juifs progressistes répondent en termes de rapprochement et de dialogue dans le respect des différences culturelles de chacun, pour s’ouvrir aux échanges d’expériences et construire un partenariat. Car les intellectuels polonais, de leur côté, luttent eux aussi pour le droit à l’autodétermination et pour une émancipation nationale et sociale.
En 1885, l’enseignante et militante pour les droits des femmes et les droits sociaux Jadwiga Szczawińska[15] crée à Varsovie une université clandestine pour les femmes, l’Université volante, qui compte parmi ses professeurs les meilleurs intellectuels et scientifiques polonais. Les cours s’ouvrent rapidement aux élèves masculins qui viennent y pallier la médiocrité de l’enseignement dispensé par l’Université tsariste de Varsovie, où Henryk Goldszmit, jeune écrivain passionné de pédagogie, étudie la médecine. L’Université volante, qu’il rejoint, se caractérise par « le scepticisme envers les soi-disant lois de l’Histoire qui allait de pair avec l’affirmation du libre arbitre des individus »[16]. L’université fonctionne en petits cercles de travail où les élèves côtoient, dans une proximité avec les enseignants renforcée par la clandestinité, des personnalités éminentes et radicales comme les pédagogues Jan Władyslaw Dawid et Wacław Nałkowski, la sociologue et économiste féministe Zofia Daszyńska-Golińska ou encore la pédagogue et activiste des droits de l’enfant Stefania Sempołowska[17]. Ces enseignants imprègnent leurs élèves de « deux impératifs moraux essentiels : celui de respecter la dignité de tout être humain, et l’obligation de solidarité avec les démunis. Grâce à eux, une nouvelle génération de Polonais a vu jour, des gens dotés d’une pensée autonome, engagés et créatifs »[18].
Sans jamais se lier à un parti politique[19], Henryk Goldszmit s’implique activement dans le mouvement social soutenu par des structures comme la Société Bienfaitrice de Varsovie et ses bibliothèques gratuites, la Société des Colonies de Vacances, la Société d’Aide aux Orphelins, ou encore l’Institut d’hygiène de Varsovie. Pour Henryk Goldszmit « les idées qui émanaient [de l’Université volante] fortifiaient les acquis d’activisme et de responsabilité sociale appris à la maison, intensifiaient le non-conformisme et le sentiment de désaccord avec la réalité, ainsi que le désir de sortir du statu quo »[20].
Ce mouvement social rallie les Polonais et les Juifs, car « l’élément commun […] était le projet de moderniser la pensée et la société en assurant et en renforçant l’identité collective. Du côté juif, pour empêcher la communauté de se dissoudre dans l’océan des adeptes d’autres religions, et du côté polonais pour se défendre contre la domination russe et la dénationalisation »[21]. Des deux côtés, l’accent est mis sur l’importance de l’éducation – des enfants comme des adultes – soutenue par des valeurs fondamentales, telle que l’amour du prochain. Une forme d’amour désintéressée et exigeante, comme l’exprime le philosophe et sociologue Zygmunt Bauman dans L’amour liquide :
Aimer son prochain peut exiger un acte de foi ; le résultat, cependant, est l’acte de naissance de l’humanité. C’est également le passage décisif de l’instinct de survie à la moralité. Passage qui fait de la moralité une partie, peut-être une condition sine qua non, de la survie. Avec cet ingrédient, la survie d’un humain devient celle de l’humanité dans l’humain[22].
Henryk Goldszmit a vingt ans à peine lorsqu’il signe en 1899, sous le pseudonyme « Janusz », une série d’articles sur l’enfance dans l’hebdomadaire La Salle de lecture pour tous, dont celui intitulé « L’évolution de l’amour du prochain » :
Les enfants ne sont pas des personnes en devenir, ce sont déjà des personnes à part entière. Oui, ce sont des individus, pas des poupées. Nous pouvons nous adresser à leur intelligence, ils nous répondront. Adressons-nous à leur cœur, ils nous comprendront[23].
Si le postulat selon lequel l’enfant est déjà une personne à part entière ne quittera jamais Korczak, la posture teintée d’utopie positiviste et de charité judéo-chrétienne du jeune pédiatre va subir un bouleversement profond en 1904, à l’occasion de son premier contact avec un groupe d’enfants. Il relatera cette expérience en 1918 dans Comment aimer un enfant. Les colonies de vacances : « Je dois beaucoup aux colonies de vacances. C’est là que j’ai rencontré une collectivité d’enfants, c’est là que j’ai appris, grâce à mes seuls efforts, le b.a.-ba de la pratique éducative. Riche d’illusions, pauvre d’expérience, sentimental et jeune, je pensais que je pourrais beaucoup parce que je voulais beaucoup. Mon désir était de faire de ces quatre semaines de colonies pour les enfants déshérités une véritable parenthèse de joie et d’allégresse qu’aucune larme ne saurait ternir.[24] » La réalité ramène le jeune éducateur sur terre dès le premier soir, quand les enfants répondent à sa bienveillance par le chahut et lui font perdre son sang-froid. Il finit par empoigner l’un d’entre eux en le menaçant de le faire dormir dehors, dans la véranda.
Le deuxième jour en début de soirée, un des garçons est venu me prévenir que ce serait à nouveau le chahut dans le dortoir, mais que si je m’avisais à frapper encore quelqu’un, ils ne se laisseraient plus faire : ils s’étaient armés de bâtons.
J’ai compris que les enfants étaient une force avec laquelle il fallait compter. On peut en faire des collaborateurs fidèles comme on peut les décourager par manque de respect. Par un curieux concours de circonstances, ces vérités m’ont été enseignées à coups de bâton.
Le lendemain, au cours d’une promenade dans la forêt, j’ai parlé pour la première fois, non pas aux enfants, mais avec les enfants. J’ai parlé avec eux non pas de ce que je voudrais qu’ils soient, mais de ce qu’ils voulaient ou pouvaient être. Je crois que c’est alors que j’ai réalisé, pour la première fois aussi, que l’on peut beaucoup apprendre des enfants, qu’eux aussi posent, et ont le droit de poser, leurs exigences et leurs conditions, qu’ils peuvent avoir leurs objections[25].
Un écrivain engagé en faveur de la cause des enfants
Cette expérience n’est pourtant pas le premier contact avec des enfants en situation précaire de celui qui, depuis son premier roman publié en 1901, se fait appeler de son nom de plume : Janusz Korczak[26]. Ce premier roman, Les enfants des rues, est une fiction élaborée à partir des notes prises lors de ses nombreuses visites dans les quartiers malfamés de Varsovie, et met en scène l’histoire d’un homme fortuné qui entreprend de sortir deux enfants de la rue en les entourant d’amour et de bienveillance. Cependant l’un des enfants préfère recouvrer sa liberté, même au prix de la misère, tandis que l’autre, restant habiter la riche demeure, se renferme sur elle-même, car : « on ne pouvait atteindre son cœur qu’avec un amour désintéressé et sincère, pas avec un amour pétri du sentiment du devoir et de l’engouement pour une idée »[27]. Korczak brosse ici des portraits d’enfants qui, malgré la précarité, incarnent une dignité et une intégrité qui font défaut au riche philanthrope.
Dans son deuxième roman, publié en 1907, L’enfant de salon, qui vaudra à Korczak sa renommée d’écrivain, le héros fuit « la violence symbolique […] de l’éducation bourgeoise qui fait de l’enfant un otage à qui il est interdit de descendre l’échelle sociale, dont l’enfance est stigmatisée par des obligations et un contrôle intensifs dissimulés sous une bienveillance sociale et familiale de façade »[28]. Dans ce roman révolutionnaire par sa forme qui mêle autobiographie, fiction, poésie, théâtre et notes journalistiques prises sur le vif, se déploie la vision d’une société avec toutes ses contradictions, ses déviances et sa folie, dont le seul garant de dignité humaine est l’enfant. Korczak dénonce la passivité des classes sociales privilégiées, responsables de la pauvreté et des maux qu’elle engendre, toutefois sans jamais idéaliser ses personnages ou les réduire au rôle de victimes en attente d’être secourues.
Lorsque quelques années plus tôt, ses amis, conscients de son talent littéraire, s’étonnaient de son choix d’études, Korczak répondait que « la littérature c’est des mots, la médecine c’est des actes »[29]. De fait, il a réussi à conduire parallèlement ces deux activités. Sa vie est un exemple difficile à égaler dans le domaine de l’engagement pour la cause des enfants démunis et victimes de violence, non seulement par l’énergie déployée sur le terrain, mais aussi par la posture intellectuellement intransigeante de Korczak quant à la manière de vivre cet engagement.
C’est aussi au cours de l’année 1907 que la Société d’Aide aux Orphelins lui confie le projet d’ouvrir à Varsovie un orphelinat moderne pour les enfants juifs. Mais quelques mois à peine après l’inauguration de la Maison de l’Orphelin éclate la Première Guerre mondiale : Henryk Goldszmit, médecin, est envoyé au front.
Dès qu’il en a la possibilité, il va prêter main-forte dans les orphelinats et les refuges pour enfants de la région de Kiev, où il reste de 1914 à 1918. C’est durant cette période qu’il écrit un texte qui deviendra le livre de référence pour quiconque s’intéresse à Janusz Korczak: Comment aimer un enfant (1918), rédigé sur des bouts de papier numérotés, « dans un hôpital de campagne sous le fracas des canons, pendant la guerre, quand le précepte de tolérance ne suffisait plus »[30].
Si le médecin, au centre de la tragédie humanitaire, dénonce le sort effroyable des enfants en temps de guerre, rien de cela ne transparait cependant dans les pages de Comment aimer un enfant : Korczak s’applique à y dépeindre une enfance ordinaire, celle d’un être humain qui vient au monde dans des circonstances et un milieu a priori favorables, où les conditions matérielles n’entrent pas en ligne de compte. Cela a de quoi surprendre. On pourrait ramener cette démarche d’écrivain à un besoin de fuir l’insoutenable horreur de la réalité. Mais Korczak n’a jamais fui devant les horreurs de la réalité, y compris – et même à plus forte raison – dans la nuit noire de l’humanité. Écrire ce livre, qu’il avait déjà en projet avant-guerre, est plus que jamais placer la dignité de l’enfant au fondement de tout : c’est un acte de résistance.
C’est dans Comment aimer un enfant que se trouve son appel à une Charte universelle des droits de l’enfant :
37. Attention. Ou bien nous nous mettons tout de suite d’accord, ou bien nous nous quittons à jamais. Un effort de volonté sera nécessaire pour rappeler à l’ordre toute pensée qui voudrait s’esquiver ou se dérober, tout sentiment flottant.
J’en appelle à la Magne Carta Libertatis [sic] des droits de l’enfant. Il y en a peut-être d’autres, j’en ai relevé trois fondamentaux.
- Le droit de l’enfant à mourir.
- Le droit de l’enfant à vivre le moment présent.
- Le droit de l’enfant à être ce qu’il est[31].
Rares sont les publications consacrées à Janusz Korczak et aux droits de l’enfant qui citent ce premier droit, le droit à mourir. Cette formulation, si elle provoque un profond malaise, s’entend dans l’esprit de Korczak comme le droit de l’enfant de ne pas avoir peur de mourir – car Korczak cible bel et bien nos propres peurs d’adultes qui, à force d’interdits imposés à l’enfant, finissent par tuer sa force vitale et son sentiment de liberté. Korczak explicite ainsi quelques pages plus loin le mécanisme par lequel parents et éducateurs abîment insidieusement la psyché de l’enfant, avec de réelles répercussions sur sa future vie d’adulte :
La crainte pour la vie de l’enfant se manifeste par la crainte d’un accident qui le rendrait infirme, ce qui réveille la crainte pour sa santé, d’où surgit le souci de l’hygiène… Et voici un nouvel engrenage : celui de la propreté et de la sécurité qui s’étend aux robes, aux bas et aux chaussures. Il ne s’agit plus du trou dans le front mais du trou dans le pantalon. Il ne s’agit plus de la santé de l’enfant mais de celle de notre portefeuille.
Cela met en mouvement le rouage de notre confort : « Ne cours pas comme ça, il y a des voitures ! Ne cours pas comme ça, tu vas te salir ! Ne cours pas comme ça, j’ai mal à la tête ! »
Et cette machine monstrueuse travaille de longues années à broyer la volonté, écraser l’énergie, user jusqu’à la trame les forces de l’enfant. […] De crainte de voir la mort nous arracher l’enfant, nous l’arrachons à la vie. Refusant qu’il puisse mourir, nous ne le laissons pas vivre[32].
Cette peur de la mort sape la confiance de l’enfant en lui-même et en l’espace dans lequel il expérimente sa prise sur la réalité. Un autre mécanisme détruit sa relation au temps : « Ayant grandi nous-mêmes dans l’attente passive et destructrice de ce qui va advenir, nous nous pressons sans cesse vers des lendemains qui chantent […] et quand le lendemain arrive, on en attend un nouveau »[33]. Cette attitude nous enferme et enferme l’autre dans une continuelle attente, au détriment du moment présent : « Une moitié de l’humanité n’existe donc pas encore »[34].
Nous avons naïvement peur de la mort, inconscients que la vie est une suite de moments qui meurent et naissent à nouveau[35].
Korczak professe ici une véritable philosophie de vie, aux répercussions immenses sur la vie d’adulte et l’organisation même de la société.
Les droits de l’enfant « à mourir », « à vivre le moment présent » et « à être ce qu’il est » relèvent ainsi, dans l’esprit de Korczak, du droit à vivre libre de l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lequel « Tous les êtres humains naissent libres et égaux » [36]. Les droits de l’enfant en constituent le socle, les êtres humains naissant enfants et non adultes. C’est pourquoi Korczak remet en cause certains énoncés paradoxaux de la Déclaration de Genève.
La Déclaration de Genève : droits ou devoirs?
Six ans après la fin de la Première Guerre mondiale, lors de l’Assemblée générale de la Société d’Aide aux Orphelins de 1924, Janusz Korczak se réfèrera une première fois à la Déclaration de Genève en ces termes :
Travaillons conformément à la fois aux injonctions éternelles et traditionnelles, et conformément à la Déclaration moderne du Conseil général de l’Union internationale de secours aux enfants.
Les différents points de la Déclaration se lisant comme suit :
« L’enfant qui a faim doit être nourri. »
« L’enfant orphelin et l’enfant abandonné doivent être recueillis et secourus. »
« L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse »[37].
En utilisant le terme « injonctions », Korczak souligne qu’assurer la protection des enfants fait de tout temps partie des devoirs des adultes. C’est une injonction adressée à tous : parents, éducateurs ou simples citoyens et par conséquent aussi à l’État. « Les enfants constituent un pourcentage important de l’humanité, de la population, de la nation, de ses habitants, de nos concitoyens – ce sont des compagnons de tous les instants. Ils l’ont été, ils le seront et ils le sont »[38]. Les enfants font partie de la société humaine et de ce fait ils sont copropriétaires de tout ce que nous avons reçu des générations précédentes. Ils ont besoin de protection car « une force injuste gouverne le monde. Celui qui le peut pille et vole. On fait du mal aux femmes ‘parce que ce sont des femmes’, aux Noirs ‘parce qu’ils sont noirs’, aux Asiatiques ‘parce qu’ils sont jaunes’, aux Juifs ‘parce qu’ils ont un nez pas comme il faut’. On maltraite les ouvriers, les paysans, les aveugles, les bossus, les vieillards et les enfants »[39].
Fils d’avocat, Janusz Korczak accordait beaucoup d’importance aux lois, aux chartes et aux réglementations qui constituaient la pierre de touche du système de l’auto-gestion de ses deux orphelinats[40]. Écrivain, il était conscient du poids des mots. En 1929, dans Le droit de l’enfant au respect, il critique la Déclaration de Genève : « Les législateurs genevois ont confondu les droits et les devoirs. Le ton de la Déclaration est celui de la sollicitation et non celui de l’exigence, c’est un appel au bon vouloir, une demande de bienveillance[41] ». Il fustige ainsi non seulement le manque de moyens matériels alloués au soin des enfants, mais aussi l’amalgame sémantique entre droits et devoirs qui, en assimilant la protection de l’enfance aux droits des enfants plutôt qu’aux devoirs des adultes, dénature le sens même de droits de l’enfant.
Le souci de subvenir aux besoins matériels des enfants nous a totalement coupés de la compréhension de leur valeur, de leurs droits et de leur force[42].
De cette confusion est née, pour paraphraser Marta Rakoczy, une politique de protection et de soin qui s’oppose à la politique du respect chère à Korczak. La politique du soin présente l’enfant uniquement à travers le prisme du manque, comme un être inachevé, fragile et vulnérable, et de ce fait impuissant.
La faiblesse de l’enfant, constituée comme un a priori à la politique de la protection de l’enfance, comporte le risque de priver l’enfant de son libre arbitre. Plus la prise en charge et la protection de l’enfant sont vues comme des valeurs essentiellement positives, plus la faiblesse qui lui est imputée est grande. Plus la faiblesse qui lui est attribuée est grande, moins on lui offre de possibilités de s’occuper lui-même de ses propres défauts et faiblesses. Pourtant, la capacité de reconnaître et de remédier soi-même à ses erreurs est fondamentale selon Korczak à l’élaboration de la vie politique[43].
La force décisionnelle des enfants
Quinze ans après la Déclaration de Genève, Korczak dressait le bilan suivant : « les politiciens et les législateurs essaient prudemment et se trompent. Ils se consultent entre eux et prennent des décisions au sujet de l’enfant, mais qui serait assez naïf pour demander à l’enfant lui-même son avis et son consentement ? Qu’est-ce qu’un enfant aurait à dire ? Et l’enfant trotte, dépité, avec son livre scolaire, son ballon et sa poupée. Il pressent qu’il se passe au-dessus de lui, sans sa participation aucune, quelque chose d’important et de grave, quelque chose qui détermine le bien et le mal, punit et récompense et brise[44]. »
Korczak s’occupait d’enfants qui avaient subi divers traumas et il voyait dans leur capacité décisionnelle, dans le sentiment de « prendre sa vie en main », une voie vers la guérison. Il ne considérait pas l’enfant comme un être faible, mais comme un individu qui a le droit d’être vulnérable et qui mérite qu’on respecte ses manquements et reconnaisse ses qualités. Ainsi, chaque enfant est traité comme un sujet unique qui possède des caractéristiques et des capacités propres qui peuvent apporter une contribution précieuse à la vie sociale, gagnant ainsi la reconnaissance des autres. C’est au respect des faiblesses, et par conséquent des forces de l’enfant, qu’appelle Korczak dans la brochure Le droit de l’enfant au respect (1929). Du respect pour son ignorance, pour ses larmes, pour ses échecs et pour le difficile et exigeant travail de son corps en croissance. En 1929, dans la deuxième édition de Comment aimer un enfant, il ajoute le commentaire suivant au chapitre 37, dans lequel il avait esquissé la Magna Carta des droits de l’enfant : « Depuis, ces idées s’étant cristallisées dans mon esprit, je pense que le premier et incontestable droit de l’enfant est celui d’exprimer ses pensées et de participer activement à nos réflexions et à nos jugements à son égard[45] ».
À un moment d’effervescence démocratique dans un pays qui vient de retrouver son indépendance, Korczak initie les enfants à la politique en créant le personnage du petit roi Mathias, qui parcourt le chemin initiatique le menant de l’enfant-roi tyrannique au dirigeant responsable. Il pose ainsi aux adultes la question de la participation des enfants au débat public dans les affaires qui les concernent :
Les ministres baissèrent la tête, Mathias n’avait encore jamais prononcé un discours aussi long et aussi juste. C’était la vérité, les enfants aussi étaient des citoyens et ils avaient donc aussi le droit de gouverner. Mais comment faire ? Les enfants allaient-ils y arriver ? N’étaient-ils pas trop bêtes ?
Les ministres ne pouvaient pas dire que les enfants étaient bêtes, puisque Mathias lui-même était un enfant. Tant pis, il faudrait essayer[46].
La démocratie étant un système fragile qui compte de nombreux ennemis, l’essai de Mathias va se solder par un échec. Or les erreurs et les échecs sont un trésor aux yeux de Korczak, en ce qu’ils possèdent une grande valeur éducative. Décrire tous les dispositifs participatifs que lui-même, Stefania Wilczyńska[47], Maria Falska[48] et les enfants qui étaient à leur charge ont expérimentés au quotidien mérite un article en soi. De formes diverses, ces dispositifs visaient à créer des espaces au sein de l’orphelinat, mais aussi dans la vie publique, où la parole des enfants serait prise en compte. Korczak voulait sortir les enfants du sentiment d’impuissance, car « le sentiment d’impuissance engendre le respect de la force. […] Nous enseignons par notre propre exemple à ignorer les plus faibles. Mauvaise école, sombre présage »[49].
© Biblioteka Narodowa, Deklaracja praw dziecka w twórczości dziecięcej

Dessin primé lors du concours de dessins illustrant la Déclaration de Genève
Un siècle plus tard, où en sommes-nous dans la compréhension des droits de l’enfant ? La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989[51] signe un tournant important, puisqu’elle constitue un document ayant force de loi. Elle pose la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et définit ce dernier comme un sujet de droit. La mise en application de la Convention est pourtant de plus en plus difficile, car elle est critiquée par les représentants de l’adultisme, qui estiment qu’il est nécessaire d’inculquer d’abord aux enfants le sens du devoir avant de leur octroyer des droits, ce qui conduit à faire des droits un privilège que l’enfant doit mériter. La Convention n’est pas non plus dénuée d’incohérences. Grzegorz Kasdepke, l’un des auteurs jeunesse les plus populaires en Pologne, le souligne avec humour dans son livre J’ai le droit ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les droits de l’enfant sans jamais oser le demander (2007). Dans la préface, Kasdepke met en scène un dialogue entre lui-même – l’auteur qui commence la rédaction du livre – et son fils Kacper, à propos des difficultés qui surgissent dès lors qu’on aborde les droits de l’enfant. Il nous aide à comprendre comment la CIDE échappe aux enfants et il attire notre attention sur le fait que ce texte, bien que visant à faire de l’enfant un acteur de sa vie, relève avant tout d’un débat entre adultes :
[…] comment écrire à propos des droits des enfants sans effrayer les adultes ?
– Effrayer les adultes ?! Kacper était abasourdi.
– Eh oui, soupirai-je. Certains disent que les enfants sont trop gâtés et qu’il faudrait parler moins des droits et plus des devoirs.
– Euh… Kacper fit la grimace.
– Tu sais… je me raclai la gorge. Peut-être qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais les devoirs sont une chose, les droits en sont une autre.
Et je me lançai dans une explication frénétique comme quoi les droits de l’enfant ne portent en aucun cas atteinte à l’autorité des parents, des tuteurs ou des enseignants. Qu’au contraire, les droits de l’enfant sont de leur côté ! Parce que, prenons un exemple, seuls les parents peuvent décider en quoi peut croire un enfant et non le gouvernement du pays dans lequel il vit. Et ainsi de suite.
– Tu comprends ? demandai-je avec enthousiasme.
– Plus ou moins, grogna Kacper[52].
En effet, si la CIDE accorde à l’enfant sa place de sujet de droit, elle instaure aussi une confusion en ce qu’elle « associe dans le discours normatif les droits et les devoirs qui, dans certains articles, deviennent impossibles à distinguer les uns des autres. Cela est particulièrement flagrant dans l’article relatif au droit à l’éducation qui est également une obligation de l’enfant »[53]. Ainsi les termes : « les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation », « encouragent », « assurent » et « favorisent » de l’article 28, sont suivis dans l’article 29 de trois occurrences des termes « inculquer à l’enfant le respect de », et « préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie », qui l’assujettissent au lieu de le rendre sujet[54]. Ce qui conduit finalement à un paradoxal : « Tu as le droit d’étudier ! »[55]. Dans Le droit de l’enfant au respect, Janusz Korczak relève cette contradiction déjà présente dans la Déclaration de Genève : « nous avons contraint les enfants au travail intellectuel »[56]. Un travail obligatoire, pour lequel les enfants ne sont pas rémunérés. Korczak attire aussi l’attention sur un autre danger de l’obligation scolaire qui fait porter à l’enfant « la lourde charge de concilier les intérêts parfois divergents de deux autorités parallèles. Les conflits entre la famille et l’école accablent l’enfant »[57]. Dans Le droit de l’enfant au respect, il réprouve le fait que la protection de l’enfance, qui est un devoir des adultes, soit présentée comme un droit de l’enfant. Il dénonce ainsi un glissement insidieux qui consiste à faire passer pour des droits des devoirs qu’on impose en réalité aux enfants. Ces incohérences qui continuent de véhiculer un modèle de domination paternaliste n’échappent pas à l’esprit vif et vigilant des enfants, particulièrement sensible au sentiment d’injustice.
Les enfants et les adolescents ne sont pas gâtés, rancuniers ou rebelles. Nous traversons en effet une période risquée. L’hypocrisie du discours humaniste sur la liberté et la bienveillance est arrivée aux oreilles des enfants[58]. Il est trop tard pour leur cacher que la loi interdit de les battre. Ils le savent. Ils réagissent à leur manière : avec des manigances, du mépris, des petites bêtises qui se voudraient méchantes ou bien ils cherchent des plus faibles qu’eux pour tester leur propre force. […] Je surveille la cause de l’enfant de très près, c’est la raison de mon pessimisme, que je pense malheureusement justifié[59].
Dans la série d’émissions radiophoniques réalisée par Louise Tourret Avoir raison avec… consacrée à Janusz Korczak et diffusée en août 2024 sur France Culture, Jodie Soret, responsable du service « Programmes, plaidoyer et affaires publiques » chez UNICEF France, admet que : « la façon de mettre en œuvre la participation des enfants aujourd’hui est un peu vide et le problème c’est qu’ils peuvent clairement le ressentir et donc finalement développer une forme de défiance envers des processus de participation »[60]. Elle poursuit en notant que les jeunes s’indignent que leur avis ne soit pas pris en compte, surtout pour les questions liées au changement climatique : « ils ont l’impression d’être mis hors-jeu, alors que c’est leur avenir qui se joue et qu’ils devraient être les premiers à être écoutés »[61]. Korczak tirait déjà la sonnette d’alarme en disant que « les doutes et les réserves émis par les enfants ne nous semblent pas sérieux » alors que :
Nous pillons les montagnes, abattons des arbres, exterminons les animaux. Des forêts et des marécages disparaissent sous nos agglomérations. Nous nous implantons toujours plus loin.
Nous avons humilié le monde, soumis le minerai et les bêtes, nous avons réduit en esclavage les peuples de couleur, nous avons grossièrement établi les relations internationales et calmé les masses. Un monde juste est encore loin, les ravages et la négligence ne font que croître.
Le sens démocratique de l’enfant est limpide et ignore les hiérarchies[62].
Un pédagogue pour adultes
Janusz Korczak / Henryk Goldszmit fut un pédagogue actif et réputé. Aujourd’hui, il est essentiellement perçu comme un pédagogue de l’enfance, alors que de son vivant son activité pédagogique était en grande partie tournée vers les adultes. Dès ses premiers articles éducatifs publiés en 1898 dans la revue Salle de lecture pour tous jusqu’aux cycles de cours et de conférences donnés à l’Institut d’État d’éducation spéciale de Maria Grzegorzewska[63], en passant par La Bourse[64] et de nombreuses prises de parole publiques, orales ou écrites, Janusz Korczak a consacré énormément de temps à l’éducation des adultes et des futurs éducateurs. Vis-à-vis des enfants, il se définissait comme « un père avec tous ses défauts : il n’a jamais le temps, il est toujours énervé par quelque chose, il est fatigant, il ne sait rien, il est strict, mais parfois, rarement, il est très gentil, très sage, il connaît beaucoup d’histoires, qu’il ne veut pas toujours raconter »[65]. Contrairement à l’usage répandu à l’époque de l’Éducation nouvelle[66] et qui est encore la norme aujourd’hui, il refusait de théoriser une méthode et mettait en garde contre une application irréfléchie des dispositifs qui fonctionnaient dans la Maison de l’Orphelin. Dans le résumé d’un cycle de cours[67] sur l’éducation participative, Korczak prévient que « tant que l’enfant n’a pas obtenu le respect qui lui est dû, tant que nous ne le reconnaissons pas comme l’expert de ses propres états psychiques et des difficultés qui peuvent en découler, tant qu’existe l’immense décalage entre ce que nous voulons et ce qu’il peut, tant que les faux-semblants et le mensonge, la contrainte et l’oppression ne seront pas remplacés par la tolérance à l’égard de son développement spontané, en accord avec la sphère de ses réels intérêts »[68], la participation des enfants sera vouée à l’échec.
De ses cours et conférences il reste quelques traces, dont l’article cité ci-avant, ou encore le résumé succinct d’un plan de cours, Les droits de l‘enfant en tant qu‘individu, composé de sept intitulés dont voici le dernier:
7) Le droit de l’enfant à la démocratisation de l’éducation. L’individualisme. L’enfant pour lui-même. Les enfants privilégiés, le chouchou, le confident, le larbin. Les fayots. Les copains insupportables. Plaintes. Sympathies et antipathies parmi les enfants. Liberté des sentiments. L’éducateur en tant que porte-parole des droits de l’enfant[69].
Marta Ciesielska fait remarquer que : « Cet ensemble de droits, singulier par sa combinaison originale de généralités et de micro-problèmes, peut être lu comme une invitation à la réflexion, à la discussion, au questionnement, voire à la recherche d’un langage informel et libre, car il ne craint pas les termes familiers, simples et expressifs. Pour que la topographie des droits de l’enfant ne se limite pas aux cercles professionnels, mais soit véritablement inclusive, et qu’elle invite à un débat général – conformément à l’appel de Korczak pour la démocratisation de l’éducation[70] ».
Vers une refonte de la Déclaration de droits de l’enfant ?
Janusz Korczak / Henryk Goldszmit était un porte-parole engagé et attentif « du droit des enfants à avoir des droits »[71]. Sans esquiver les polémiques, n’hésitant pas à en déclencher lui-même, toujours prêt au débat, il se situait pourtant au-delà des clivages, faisant partie « de ces êtres rares qui, tout au long d’une vie lucide voient le monde à partir de son centre, car ils se trouvent au centre d’eux-mêmes »[72].
Korczak aimait les enfants comme peu d’entre nous sont prêts ou capables, mais ce qu’il aimait chez eux était leur humanité. L’humanité sous sa forme la meilleure – ni déformée, ni tronquée, ni réduite, ni mutilée, complète dans sa naissance et son inachèvement enfantins, pleine d’une promesse pas – encore – trahie et d’un potentiel toujours intransigeant. […] Il vaudrait peut-être mieux changer les habitudes du monde et faire de l’habitat humain un lieu plus accueillant pour la dignité humaine, afin que prendre de l’âge n’exige pas la compromission de l’humanité de l’enfant[73].
Henryk Goldszmit, enfant d’une famille polonaise juive progressiste, jeune étudiant révolté contre l’oppression sociale et étatique, médecin et éducateur qui a voué sa vie à protéger les enfants sans jamais perdre de vue leurs droits, a été assassiné à Treblinka.
Janusz Korczak, écrivain, penseur, éducateur des adultes formé par les enfants, est vivant. « Ce personnage mythique qui entaille le monde avec le tranchant d’un scalpel »[74] nous invite à nous « hisser à la hauteur des enfants »[75] parce que nous partageons ce monde avec eux. Il nous demande de mettre de côté notre attachement à « l’autorité » pour accéder à ce que les enfants peuvent nous offrir. Janusz Korczak nous invite à nous engager sur un chemin difficile, celui des questions et des remises en question. Il nous demande de revoir notre conception des droits de l’enfant car, comme le dit Manfred Liebel : « Si nous comprenions l’essence des droits de l’enfant comme les droits ‘‘des’’ enfants, c’est-à-dire des droits qu’ils peuvent eux-mêmes établir et mettre en œuvre (ou qui garantissent que les décisions qui les concernent ne puissent être prises contre leur volonté), alors l’histoire des droits de l’enfant en est encore à ses débuts[76] ». La coopération avec les enfants, la valorisation de ce qu’ils sont, de ce qu’ils nous apportent et nous enseignent, est un choix de civilisation porteur de profonds changements. Ce choix est-il trop difficile, trop dangereux pour notre monde ?
Footnotes
[1] Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak (J. Mortkowicz, 1949). Hanna Mortkowicz-Olczakowa (1905-1968) était la fille des amis et éditeurs de Janusz Korczak, Janina et Jakub Mortkowicz. Elle est aussi la mère de Joanna Olczak-Ronikier qui signera à son tour une biographie de Korczak en 2002.
[2] Les citations des auteurs suivants ont été traduites du polonais vers le français par Eliza Smierzchalska : Marta Ciesielska, Grzegorz Kasdepke, Janusz Korczak, Manfred Liebel, Piotr Matywiecki, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Joanna Olczak-Ronikier, Marta Rakoczy et Bożena Wojnowska. Pour les textes de Janusz Korczak, la traductrice s’est référée aux Œuvres (Dzieła) (Varsovie, 1992-2022).
[3] Le point de rassemblement d’où les Juifs du ghetto de Varsovie étaient déportés à Treblinka.
[4] Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak, 8-9.
[5] Janusz Korczak, Dzieła, 16 t. (IBL, Latona, 1992–2025). Hanna Kirchner (1930), Alexander Lewin (1915-2002) et Stefan Wołoszyn (1911-2004) étaient membres du Comité pour la célébration du centenaire de la naissance de Janusz Korczak, comité dont Marta Ciesielska a été nommée secrétaire. L’entreprise éditoriale a été soutenue au fil des ans par différentes associations et institutions, polonaises et internationales. En plus du travail de membres du Comité éditorial, les Œuvres (Dzieła) sont le fruit de la collaboration de plusieurs autres historiens et chercheurs.
[6] Dzieła, t. 13, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919-1939) (IBL, 2017).
[7] Bożena Wojnowska, Inna twarz Korczaka. Szkice o dwoistej tożsamości (i nie tylko) (Austeria, 2023.)
[8] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 7. La Haskala est le mouvement juif des Lumières porté par le philosophe allemand Moses Mendelssohn (1729-1786).
[9] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 7.
[10] On ignore si Korczak est né le 22 juillet 1878 ou 1879. Lui-même hésitait sur l’année de sa naissance.
[11] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 23-25.
[12] Anna Goldszmit (1875-1942) fut traductrice assermentée.
[13] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 25.
[14] Józef Goldszmit et Jakub Goldszmit, O prawo do szacunku. Wybór pism, dir. Bożena Wojnowska et Marlena Sęczek (IBL, 2017).
[15]Jadwiga Szczawińska-Dawidowa (1864-1910) épousa Jan Władyslaw Dawid, éditeur de la revue de gauche radicale La Voix, dans laquelle Henryk Goldszmit publia plusieurs articles.
[16] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 102.
[17] Stefania Sempołowska, institutrice, écrivaine, journaliste et activiste sociale est une figure emblématique de la lutte pour les droits de l’enfant en Pologne.
[18] Joanna Olczak-Ronikier, Korczak : Próba biografii (W.A.B., 2012), 88.
[19] Tout en étant proche des milieux de gauche, Korczak n’a jamais appartenu à un parti politique. C’est ce que lui reprocheront dans les années 1930 ses anciens pupilles, déçus de son refus de soutenir publiquement les combats marxistes et/ou sionistes.
[20] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 94.
[21] Wojnowska, Inna twarz Korczaka, 26.
[22] Zygmunt Bauman, L’amour liquide : de la fragilité des liens entre les hommes (Éditions du Rouergue, 2004), 97.
[23] Janusz Korczak, « Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku » dans Dzieła, t. 3/1, Na mównicy. Publicystyka społeczna, 1898-1912 (Latona, 1994), 223.
[24] Janusz Korczak, « Jak kochać dziecko », dans Dzieła, t. 7, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku (Latona, 1993), 220.
[25] Korczak, « Jak kochać dziecko », 232 et suivantes.
[26] Henryk Goldszmit a commencé à publier dès l’âge de 18 ans dans plusieurs revues éducatives, sociales ou satyriques, en utilisant différents pseudonymes. Le pseudonyme « Janusz » est en lien avec les articles qui traitent de l’enfance et qui étaient publiés dans La salle de lecture pour tous, revue éducative de gauche dans laquelle il était particulièrement impliqué. Lors d’un concours littéraire, il utilisera le pseudonyme « Korczak », nom du héros d’un roman de Kraszewski qui incarnait les idéaux de respect de l’autre et de coopération entre Polonais et Juifs si chers à la famille Goldszmit. Le pseudonyme « Janusz Korczak », qui finira par supplanter son nom civil, serait ainsi lié à la volonté de Henryk Goldszmit d’incarner le combat engagé pour la défense du respect de l’enfant.
[27] Janusz Korczak, « Dzieci ulicy », dans Dzieła t. 1 : Dzieci ulicy. Dziecko salonu (Latona, 1992), 192.
[28] Marta Rakoczy, “Prawa dziecka według Korczaka. Polityka szacunku przeciw polityce troski”, Dialog 6, n° 787 (juin, 2022), https://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/prawa-dziecka-wedlug-korczaka-polityka-szacunku-przeciw-polityce-troski.
[29] Janusz Korczak, « Spowiedź motyla », Dzieła, t. 6, Sława. Opowiadania (1898-1914) (Latona, 1994), 176.
[30] Korczak, « Jak kochać dziecko », 113.
[31] Korczak, « Jak kochać dziecko », 43.
[32] Korczak, « Jak kochać dziecko », 46.
[33] Korczak, « Jak kochać dziecko », 46.
[34] Korczak, « Jak kochać dziecko », 46.
[35] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », dans Dzieła, t. 7, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku (Latona, 1993), 453.
[36] AG Rés. 217 (III) A, Déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948), art. 1.
[37] Janusz Korczak, « Sprawozdanie Towarzystwa ‘Pomoc dla Sierot’ za rok 1924 », Dzieła, t. 14*: Pisma rozproszone, Listy, 1913-1939 (IBL, 2008), 121.
[38] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 447.
[39] Janusz Korczak, « Nie wróżę powodzenia! », dans Dzieła, t. 13, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne. (1919-1939) (IBL, 2017), 64.
[40] La Maison de l’Orphelin était un orphelinat pour les enfants juifs, et Notre Maison, dirigé par Maria Falska, pour les enfants catholiques.
[41] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 448.
[42] Korczak, « Nie wróżę powodzenia! », 64.
[43] Marta Rakoczy, « Prawa dziecka według Korczaka ».
[44] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 430-431.
[45] Korczak, « Jak kochać dziecko », 43.
[46] Janusz Korczak, Le roi Mathias 1er, trad. Eliza Smierzchalska (Éditions du Rocher, 2017), 196.
[47] Stefania Wilczyńska (1886-1942), éducatrice, fut la plus proche collaboratrice de Janusz Korczak. Impliquée dès le début dans le projet de la Maison de l’Orphelin, elle y vivra et s’en occupera toute sa vie. Elle aussi mourra assassinée avec les enfants à Treblinka.
[48] Maria Rogowska-Falska (1877-1944), pédagogue, dirigea l’orphelinat pour enfants catholiques Notre Maison, fondé en 1919 avec Janusz Korczak.
[49] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 430.
[50] Le concours a été organisé par le Comité polonais de la protection de l’enfance, et les dessins primés ont été publiés en 1928 dans la brochure Deklaracja praw dziecka w twórczości dziecięcej (Warszawa, 1928). La légende mentionne : « 1. Dessin sur le thème : ‘L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une façon normale, spirituellement’ exécuté par H.K.,11 ans, élève du collège de Bydgoszcz ».
[51] AG Rés. 44/25, Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989).
[52] Grzegorz Kasdepke, Mam prawo! czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!, 6e éd. (Wydawnictwo Literatura, 2022), 6-7.
[53] Rakoczy, « Prawa dziecka według Korczaka ».
[54] AG Rés. 44/25, arts. 28 et 29.
[55] Kasdepke, Mam prawo !, 105.
[56] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 448.
[57] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 448.
[58] Souligné en gras par l’autrice.
[59] Janusz Korczak, « Dzieci-bóstwa i dzieci ubóstwa », dans Dzieła t. 13, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne. (1919-1939) (IBL, 2017), 145.
[60] Louise Tourret, animatrice, Avoir raison avec…, podcast, épisode 4, “Janusz Korczak, l’invention du droit des enfants”, Radio France, 8 août 2024, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec/janusz-korzcak-l-invention-du-droit-des-enfants-8142445.
[61] Tourret, Avoir raison avec.
[62] Korczak, « Prawo dziecka do szacunku », 432 et suivantes.
[63] Maria Grzegorzewska (1888-1967), docteure en philosophie à la Sorbonne, proche amie et collaboratrice de Korczak, dirigera l’Institut d’État d’éducation spéciale de 1922 jusqu’à sa mort.
[64] Programme de soutien aux jeunes étudiants qui offrait logement et nourriture en échange de quelques heures d’activité avec les enfants. La Bourse était avant tout destinée aux futurs travailleurs de l’enfance désireux de faire un stage à l’orphelinat de Korczak pendant leurs études à Varsovie.
[65] Janusz Korczak, « Do nieznanego adresata », dans Dzieła, t. 14**, Pisma rozproszone. Listy, (IBL, 2008), 220.
[66] L’Éducation nouvelle est un courant pédagogique humaniste né à la fin du XIXe siècle, qui s’appuie sur les principes d’une participation active des individus à leurs apprentissages. Ses figures les plus connues aujourd’hui sont Maria Montessori, Ovide Decroly ou encore Célestin Freinet.
[67] Formation de deux ans pour enseignants en exercice à l’Institut national d’enseignement de Varsovie.
[68] Janusz Korczak, « Z zagadnień wychowania zakładowego », dans Dzieła, t. 13, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919-1939) (IBL, 2017), 220.
[69] Janusz Korczak, « Prawa dziecka jako jednostki », dans Dzieła, t. 13, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne. (1919-1939) (IBL, 2017), 314.
[70] Marta Ciesielska, « [Janusz Korczak] Prawa dziecka jako jednostki, opracowała Marta Ciesielska », Przegląd Krytyczny 2, n° 1 (2020) : 126, https://doi.org/10.14746/pk.2020.2.1.08.
[71] Bogusław Śliwerski, « Prawo dziecka do swoich praw », dans Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska, dir. Marek Michalak (Biuro Rzecznik Praw Dziecka, 2018), brpd.gov.pl..
[72] Piotr Matywiecki, « Jak Henryk Goldszmit wychował Janusza Korczaka », Midrasz: pismo żydowskie 12, n° 68 (2002) : 17.
[73] Bauman, L’amour liquide, 102-103.
[74] Matywiecki, « Jak Henryk Goldszmit », 17.
[75] Janusz Korczak, « Kiedy znów będę mały », Dzieła, t. 9, Bankructwo małego Dżeka. Kiedy znów będę mały (Latona, 1994), 185.
[76] Manfred Liebel, « Nieznane aspekty historii praw dziecka », dans Prawa dziecka w kontekście międzykulturowym: Janusz Korczak na nowo odczytany (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017), 44