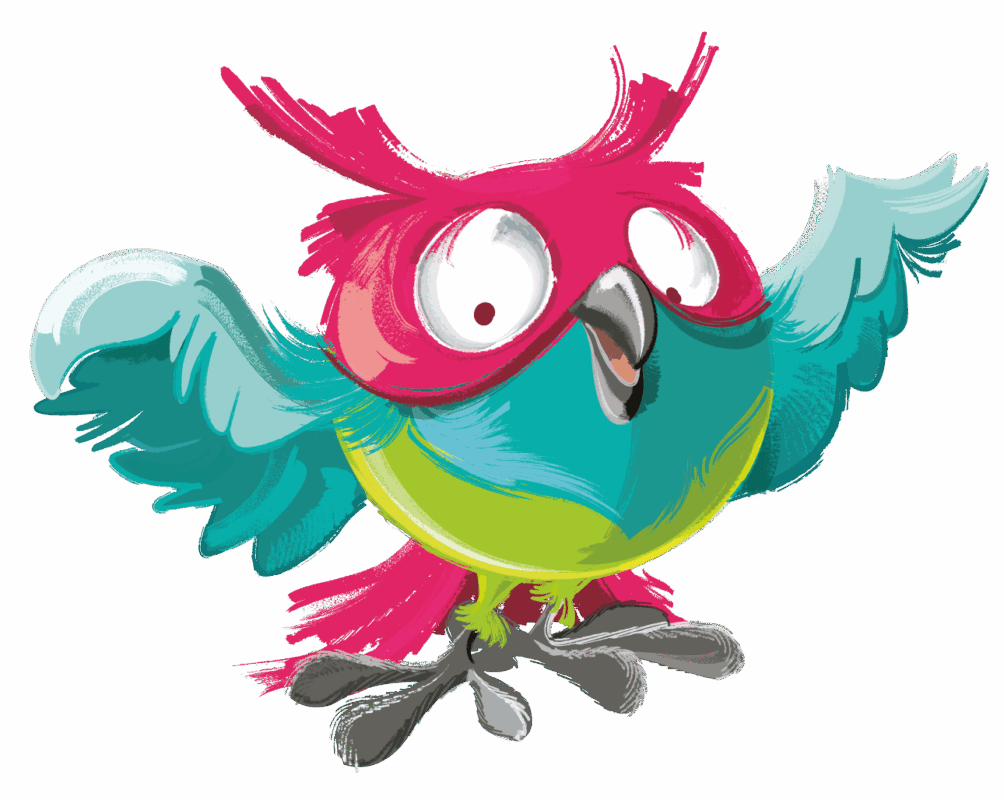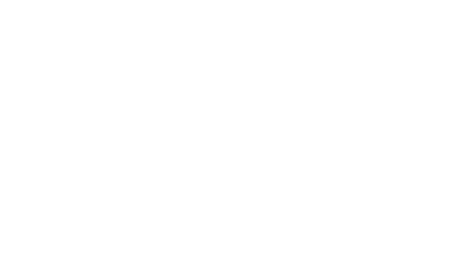La Déclaration de Genève a fait connaître les Droits de l’enfant. Mais avons-nous fait des progrès depuis ?
Dr. Philip E. Veerman
Le Dr. Philip E. Veerman est un psychologue multilingue agrée et renommé, spécialisé en psychologie judiciaire, en psychologie de la santé et en droits de l’Homme.
Très actif sur le plan académique, il a lancé des projets aux Pays-Bas, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Il a travaillé pendant dix ans en tant qu’expert judiciaire pour les tribunaux néerlandais. Expert en droits de l’enfant, en enfance, en protection de l’enfance, en traite (des enfants), en droits de l’homme internationaux et en coopération internationale, il a travaillé avec des enfants, des adultes et des familles au sein de différents services et équipes multidisciplinaires. Il a dirigé un groupe de travail international et interdisciplinaire sur les idéologies des droits de l’enfant, qui a mené à la création de l’International Journal on the Rights of the Child.
Le 23 février 2023 marqua le centenaire de l’adoption à Genève de la première Déclaration internationale des droits de l’enfant par le Conseil général de l’Union internationale de secours aux enfants[2]. L’anglaise Eglantyne Jebb, fondatrice de l’organisation Save the Children, joua un rôle important dans l’élaboration de ce texte et c’est elle qui proposa de le nommer Déclaration de Genève.
Dans le présent chapitre, j’aborderai les rôles respectifs d’Eglantyne Jebb, de Save the Children et de l’UISE et tâcherai de replacer la Déclaration de Genève dans son contexte[3]. Je me pencherai également sur les « améliorations » apportées à la déclaration en 1924, lorsqu’elle fut adoptée par la Société des Nations. Enfin, j’essayerai de répondre aux questions suivantes : la déclaration est-elle encore pertinente aujourd’hui, comment les droits de l’enfant ont-ils évolué depuis que la déclaration a été adoptée et avons-nous fait des progrès depuis ?
Penser l’Histoire est une nécessité
Dans le magazine The New Yorker, Eric Alterman faisait remarquer qu’il existe un fossé entre « quelques personnes qui ont la capacité de comprendre notre société » et les autres[4]. Dans la suite de l’article, Alterman affirmait que la connaissance de l’histoire est un bon outil pour comprendre la société : « cela […] nous aide à comprendre comment nous en sommes arrivés où nous en sommes et pourquoi les choses sont ce qu’elles sont ». Alterman se disait préoccupé de la baisse du nombre d’étudiants en histoire dans de nombreuses universités américaines. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, le journaliste Bas Heijne plaide pour que l’on n’abandonne pas l’enseignement de l’histoire dans le secondaire[5]. Bien sûr, je trouve préoccupant que les étudiants en pédagogie et en psychologie (développementale) en apprennent si peu sur Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Ellen Key, John Dewey et Janusz Korczak ainsi que sur leurs approches, théories, concepts et idées. Le professeur d’université néerlandais, Willem Koops écrit que « la conscience historique est en train de disparaître dans les sciences sociales en général, mais en particulier en psychologie et même en pédagogie. Il est dès lors normal que les étudiants en sciences sociales pensent que les textes publiés depuis plus de cinq ans sont obsolètes et qu’ils doutent de leur importance. La conséquence est que la roue doit être réinventée tous les jours, ce qui est un grand danger pour les sciences (sociales) d’aujourd’hui »[6].
J’essaierai par conséquent de montrer qu’il est important de prendre en compte l’histoire du mouvement des Droits de l’enfant, pour peser la valeur de la Déclaration de Genève.
Le changement de l’image de l’enfant
Il faut également garder à l’esprit qu’il existe diverses manières de penser l’histoire. Dans mon livre, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood[7], je m’appuie sur le travail de Philippe Ariès. Jusqu’à la publication en 1960 de son livre sur l’histoire de l’enfance, des concepts comme « enfant », « jeunesse » et « adolescence », étaient considérés comme invariables et intemporels. Mais au Moyen Âge par exemple, le concept d’« enfant » n’existait pas[8]. Le livre d’Ariès déclencha une véritable polémique autour de la question suivante : est-ce que l’image que nous nous faisons de la nature particulière des enfants est restée constante au fil du temps ou est-ce qu’Ariès a raison d’affirmer que l’image de l’enfance a radicalement changé depuis le Moyen Âge ? Dans mon ouvrage, j’arrive à la conclusion que l’image de l’enfance a bel et bien changée au XXe siècle, comme l’illustre le glissement de ce que nous considérons être les droits de l’enfant : de la perception de l’enfant comme objet de droits qui a besoin de protection à la perception de l’enfant comme un sujet de droits dont l’opinion est exprimée et sollicitée.
Dans une critique des thèses d’Ariès, John Tobin déclare que « la conception moderne de l’enfance que mettent en avant Ariès et ceux qui sont d’accord avec lui, est bien évidemment une conception occidentale. Elle s’applique aux sociétés développées du Nord globalisé »[9]. Tobin admet néanmoins que l’importance du travail d’Ariès « ne réside peut-être pas tant dans l’affirmation que le concept d’enfance est une invention moderne, que dans celle qu’il y a une conception de l’enfance spécifique à la modernité »[10].
Cent ans plus tôt, en élaborant la Déclaration de Genève, Eglantyne Jebb et l’Union internationale de secours aux enfants réussirent à faire reconnaître les droits des enfants pour la première fois[11]. Je vais maintenant exposer pourquoi l’adoption de cette déclaration fut si importante, qu’elles en étaient les objectifs et quels types de droits ont été proclamés.
Eglantyne Jebb : contribuer à rendre ce monde meilleur
Née en 1876 dans l’Angleterre victorienne, Eglantyne Jebb était la quatrième d’une famille de sept enfants plutôt aisée, qui vivait dans le comté du Shropshire dans les West Midlands[12]. Le père d’Eglantyne possédait un domaine et avait confié l’éducation de ses enfants à des gouvernantes. L’une d’entre elles, qui était alsacienne, avait appris le français et l’allemand à Eglantyne. La famille n’était pas conservatrice ; elle avait foi dans l’éducation des femmes. En 1895, Eglantyne fut envoyée étudier à au Lady Margaret Hall, à Oxford. L’année suivante, elle intégra une école normale à Stockwell, un quartier du sud de Londres. Après la mort de son père en 1894, Eglantyne s’installa avec sa mère, qui habitait alors à Cambridge. Dans une biographie écrite dans les années 1960, Francesca Wilson décrit Eglantyne comme une rebelle[13]. Elle entendait peut-être par là qu’Eglantyne avait choisi de ne pas se marier (contrairement à ce qu’on attendait des jeunes filles à cette époque) pour pouvoir contribuer à rendre le monde meilleur. J’y vois une ressemblance avec un autre pionnier des droits de l’enfant, Henryk Goldszmit, qui écrivait sous le nom de plume de Janusz Korczak. Celui-ci se souvenait s’être trouvé dans un parc de Londres, au cours d’un voyage depuis sa Pologne natale, lorsqu’il décida que plutôt que d’avoir des enfants, il choisirait « l’idée de servir l’enfant et ses droits »[14]. Les droits des enfants donnèrent à Jebb[15] tout comme à Korczak[16] un but dans l’existence. Tous les deux connurent régulièrement des épisodes de dépression. Mais leur attitude à l’égard des enfants différait toutefois. Korczak vécut heureux parmi eux dans un orphelinat juif de Varsovie de 1912 à 1942, jusqu’à ce que les Allemands les déportent au camp de concentration de Treblinka. Eglantyne quant à elle, « avait un intérêt plutôt tiède pour les droits et […] manquait singulièrement d’affection pour les enfants »[17], ce qui, selon sa biographe Clare Mulley, « semble faire d’Eglantyne une improbable défenseure des droits des enfants »[18].
Les sources disponibles dans les archives, me donnent l’impression que la famille d’Eglantyne, en particulier sa mère et l’une de ses sœurs, Dorothy Buxton, l’ont toujours soutenue dans ses activités et que Dorothy a eu une forte influence sur elle. La plupart des membres de la famille d’Eglantyne étaient connus pour leur engagement social. La mère d’Eglantyne avait sa propre organisation pour former les femmes pauvres aux métiers de l’artisanat. Sa sœur Louisa (« Lili ») Wilkins aida le ministère britannique de l’Agriculture à créer la Women’s Land Army, une organisation qui pendant la Première Guerre mondiale mobilisa des femmes aux champs pour remplacer les hommes qui avaient été enrôlés dans l’armée. Je ne pense pas par conséquent que la famille d’Eglantyne la considérait comme une « rebelle ». Mais au cas où elle le fut, à partir de 1919, elle ne resta pas sans cause, puisqu’elle embrassa celle des enfants.
En 1913, le Macedonian Relief Fund demanda à Eglantyne Jebb d’aller en mission d’observation dans les Balkans où elle fut « un témoin de premier plan de la détresse des réfugiés » qui vivaient dans une promiscuité extrême, « où les membres d’une même famille devaient se relayer pour dormir et où les enfants grelottaient dans le froid en attendant que des portions de soupe soient distribuées »[19]. Sa sœur Dorothy était féministe. Elle était membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, un mouvement internationaliste dont de nombreuses adhérentes s’étaient déjà auparavant battues pour le droit de vote des femmes. Dorothy devint socialiste et également pacifiste. Elle était plus extravertie et plus directe qu’Eglantyne. Frêle et de santé fragile, la force de cette dernière résidait plutôt « dans ses yeux bleus » qui sondaient la conscience de ses interlocuteurs.
La Société des Nations voit le jour, le blocus alimentaire continue
Le 16 septembre 1918, lorsque les Autrichiens demandèrent des négociations de paix et les Bulgares un cessez-le-feu, les Alliés comprirent qu’ils étaient sur le point de remporter la Première guerre mondiale. Ils ne levèrent pas pour autant le blocus sur les denrées alimentaires qu’ils imposaient aux Empires centraux.
Cette pratique était héritée de la stratégie militaire qui consistait à assiéger une ville pour affamer ses habitants et les contraindre à se rendre. Le blocus continua même, après le 3 octobre 1918, quand l’Empereur Guillaume II prit la fuite pour les Pays-Bas et que le gouvernement allemand demanda l’armistice.
Herbert Hoover, futur président des États-Unis qui était alors le coordinateur pour l’assistance alimentaire en Europe, écrivit dans ses mémoires « que poursuivre le blocus alimentaire quatre mois après l’armistice était un péché contre la sagesse politique et l’humanité tout entière »[21].
Hoover écrit : « …J’insistais sur le fait que la guerre ne serait pas gagnée par le blocus alimentaire imposé aux femmes et aux enfants, mais par un embargo sur les armes et des actions militaires ». D’après lui, « la mortalité infantile augmenta de 30 % en Allemagne après la guerre, tandis qu’un tiers des enfants tombèrent malades en raison de la malnutrition »[22]. La conférence de la paix de Paris (1919-1920) déclara que lancer une guerre d’agression était un crime et que les États avaient donc pour mission de prévenir ce type de conflit. Une décision importante prise à la conférence de la paix de Paris fut d’accepter la proposition de créer la Société des Nations. Il fallut toutefois attendre un an avant que cette organisation, prédécesseuse des Nations Unies, ne tienne sa première réunion.
Reconnaissance d’Eglantyne Jebb comme fondatrice du Save the Children Fund
Eglantyne Jebb recueillait et partageait des renseignements importants et, à l’instar de sa sœur plus engagée politiquement et plus extravertie, elle rejoignit le Fight the Famine Council. Pour mettre fin au blocus et faire parvenir de l’aide alimentaire aux anciens ennemis, le comité utilisait des tactiques comme la sensibilisation, l’envoi de lettres, la publicité et le lobbying auprès des hommes politiques – les mêmes tactiques que celles utilisées aujourd’hui par les organisations non gouvernementales[23].
Lord Parmoor (Charles Alfred Cripps), des députés du parti travailliste ainsi que des syndicalistes apportèrent leur soutien au Fight the Famine Council. Malgré cela, le gouvernement britannique ne changea pas de position.
Nouvelles tactiques
Pour attirer davantage l’attention, le Fight the Famine Council décida lors d’une réunion tenue le 15 avril 1919 de créer le Save the Children Fund. Cette initiative devait servir une cause politique plus large (tel était certainement l’avis de Dorothy, la sœur d’Eglantyne). Mais même limitée à la nécessité d’apporter un aide alimentaire aux enfants des ennemis d’hier, elle fit polémique. Les militants du Fight the Famine Council se firent remarquer lorsque Eglantyne Jebb distribua sur Trafalgar Square, à Londres, des tracts contenant le texte suivant : « Notre blocus a causé cela ! Dans toute l’Europe, des millions d’enfants meurent de faim. Nous sommes responsables. Écrivez à Lloyd George et dites que vous n’êtes pas d’accord. Levez le blocus partout ».
Eglantyne Jebb n’avait pas soumis ce texte à la censure avant son impression et écopa d’une amende de cinq livres pour comportement antipatriotique. Elle refusa de s’en acquitter pour attirer l’attention davantage encore. Cette publicité contribua à faire du premier meeting du Save the Children Fund au Royal Albert Hall un succès. Eglantyne Jebb y fit son entrée au bras de George Bernard Shaw. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il soutenait cet événement antipatriotique, Shaw répondit : « Je n’ai pas d’ennemis de moins de sept ans »[24].
La « fondatrice oubliée » du Save the Children Fund : Dorothy Buxton
Cent ans après la naissance d’Eglantyne Jebb, une cérémonie fut organisée au siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Le président du Save the Children Fund, Lord Gore-Booth, y évoqua la mémoire de deux Anglaises exceptionnelles « qui firent tant pour soulager la souffrance humaine, Florence Nightingale et Eglantyne Jebb »[25]. Cette dernière fut quasiment élevée au rang de sainte[26]. Emily Baughan[27] et Juliano Fiori[28] ont eu le mérite d’avoir davantage mis en lumière Dorothy Buxton, la sœur d’Eglantyne Jebb, dont les mérites ont été sous-estimés dans les écrits de Francesca Wilson[29], Mulley[30], Waltraut Kerber-Ganse[31] et Gilian Wilson[32], ainsi que dans mon propre livre, dans le chapitre consacré à Eglantyne Jebb[33]. En lisant Baughan, on a l’impression qu’il n’y avait pas de rivalité entre les deux sœurs. Pourtant la jeune organisation qu’était le Save the Children Fund a délibérément changé de cap, se transformant d’un groupe de pression politique engagé, pour lequel l’aide aux enfants n’était qu’une tactique visant à atteindre ses véritables objectifs, à savoir des conditions de paix plus équitables, des liens plus étroits entre les nations et le libre-échange, en organisation humanitaire neutre dont l’unique objectif était d’aider les enfants.
Baughan pense que c’est Dorothy Buxton qui poussa sa sœur à distribuer les tracts sur Trafalgar Square, sachant pertinemment que cela entraînerait son arrestation, mais aussi que ce coup de publicité servirait la cause[34]. Eglantyne paraissait bien moins « compromise » que Dorothy qui déjà connue en tant que féministe et socialiste. L’impression que Baughan a retiré de la lecture de nombreux documents d’archives, est que la sœur d’Eglantyne avait fait un choix stratégique pour montrer que faire un don pour la cause des enfants était un acte apolitique et n’avait rien d’antipatriotique. Le fait de se tenir en retrait et de pousser Eglantyne à prendre la direction du Save the Children Fund, illustrait, selon Baughan, un tournant politique et une intention délibérée de dépolitiser l’image de Save the Children auprès du public[35].
Une image nouvelle et apolitique
La nécessité d’une telle image apolitique devint évidente en 1921, lorsque le Save the Children Fund achemina de la nourriture en Union Soviétique où sévissait une famine. Méfiants, les Soviétiques hésitèrent d’abord à accepter l’aide de cette organisation nouvellement créée. Mais le fait que Charles Roden Buxton[36], l’époux de Dorothy, avait fait partie d’une délégation du parti travailliste reçue en Russie[37], finit par convaincre les Soviétiques de faire confiance au Save the Children Fund. À la recherche de la bonne stratégie de relations publiques, le Save the Children Fund trouva dans ces années-là la « formule magique » pour lever des fonds en découvrant « le pouvoir de l’image d’enfants victimes de la faim »[38]. Les photographies soulignaient l’innocence des enfants. De même, pour son logo, le Save the Children Fund choisit un nourrisson emmailloté, inspiré de l’un des fameux carreaux de céramique du sculpteur Andrea de la Robbia (1435-1525), visibles sur la façade de l’orphelinat pour les enfants trouvés de l’Ospedale degli Innocenti à Florence (qui abrite aujourd’hui l’Innoncenti Resarch Center de l’UNICEF).
La Save the Children International Union
Save the Children fit son entrée officielle sur la scène des organisations non gouvernemantales internationales le 6 janvier 1920. Le lancement eut lieu dans le grand salon du Palais de l’Athénée, où avait également été fondé le Comité International de la Croix Rouge. Le Save the Children Fund (d’Eglantyne et Dorothy) et le Comité international de secours aux enfants (de Berne) fondèrent ensemble l’Union internationale de secours aux enfants, « sous le patronage du CICR [Comité International de la Croix Rouge] »[39]. Un des principes du Comité étant la stricte neutralité, il n’aurait jamais accepté le patronage de cette organisation si la neutralité n’avait pas été l’un des principes de travail de l’Union internationale de secours aux enfants. L’Union entendait « s’abstenir de toute action directe, mais centraliser et distribuer des fonds pour soulager en tous lieux la misère des enfants »[40]. Un tel patronage est unique dans l’histoire du Comité International de la Croix Rouge.
Internationalisme
Eglantyne Jebb ne se contenta pas de créer cette organisation non gouvernementale nouvelle dans le but de coordonner les activités de secours à travers le monde, elle ajouta la protection de l’enfance au nombre de ses missions. Elle était par ailleurs convaincue que les enfants « favoriseraient la réconciliation entre les nations et promouvraient un internationalisme d’un type nouveau – ce qu’elle appelait le “supranationalisme” »[41]. Cette vision romantique du monde exprimait l’espoir que les enfants seraient un instrument de la paix. Eglantyne était également très à l’aise dans la communication avec les personnes que nous appellerions aujourd’hui des VIP. Ses efforts pour établir des relations avec des personnalités aussi influentes que le dirigeant libéral suisse Gustave Ador et le baron C. F. de Geer se révélèrent payants. Ador fut ministre du Conseil national Suisse de 1889 à 1917 et son président en 1901[42]. Il présida aussi le Comité International de la Croix Rouge de 1910 à 1928. Eglantyne Jebb demanda à la plupart de ces personnalités de devenir membres du Conseil général de l’Union internationale de secours aux enfants, qui se réunissait au moins une fois par an. Gustave Ador était sans doute la plus influente de ces personnalités, et il plaidait fortement pour que Genève joue un rôle central dans les organisations internationales. C’est grâce à son action que la Société des Nations, fondée en 1919, déménagea de Londres à Genève en 1920. Il y avait aussi une compétition avec les Belges, qui bataillaient dur pour faire de Bruxelles l’épicentre des activités de protection des enfants[43]. Dans un excellent article, Dominique Marshall montre qu’il n’y avait pas alors de consensus parmi les hommes politiques sur le nouveau statut de l’enfance, au contraire, « chaque point était contesté »[44]. En outre, les tentatives de créer un comité de protection de l’enfance au sein de la Société des Nations échouèrent en raison des oppositions et des concurrences internes[45].
Entre-temps, Eglantyne Jebb et Dorothy Buxton étaient parvenues à inciter un groupe d’éminentes pacifistes et féministes suédoises à mettre sur pied un Save the Chidren Fund en Suède (Rädda Barnen). Lindkvist, qui s’est penché sur l’histoire du Save the Children Fund suédois, écrit : « Ces femmes n’étaient pas sentimentales, ni ‘‘charitables” au sens classique du terme. Elles travaillaient pour aider les enfants miséreux […] mais ne parlaient pas exclusivement de charité. D’emblée, elles ont parlé de droits, de solidarité, de devoirs sociaux, d’aide à l’autonomie »[46].
1923 : une année de crise
Le journaliste et historien néerlandais Frans Verhagen qui a écrit un livre sur l’année 1923, l’a décrite comme « l’année charnière […] cinq ans après la ‘‘Grande Guerre”, de nombreux pays ont pris un nouveau tournant. Nous pouvons dire que ce tournant eut des conséquences énormes sur le long terme »[47]. Se référant à la situation en Allemagne, l’écrivain Volker Ulrich a décrit 1923 comme l’année qui a précédé « la chute dans l’abîme »[48].
Le 11 janvier 1923, les troupes françaises et belges occupèrent la Ruhr pour obliger l’Allemagne à payer les réparations qui lui avaient été imposées par le traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale[49]. L’Union internationale de secours aux enfants étant (selon Bolzman[50]) née du souhait de ses fondateurs de parvenir à « la pacification et l’unification des nations », son assemblée générale se réunit le 23 février 1923, au beau milieu de la crise.
L’idée d’une déclaration
Eglantyne Jebb et l’Union internationale de secours aux enfants n’étaient pas les seules à avoir eu l’idée d’une déclaration des droits de l’enfant. Dans mon livre The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood[51], je cite la plupart des déclarations antérieures susceptibles d’avoir inspiré Jebb. Il se peut que Dorothy Baxton et son époux, qui s’étaient rendus en Russie, aient eu connaissance de la déclaration des droits de l’enfant, présentée quatre mois après la révolution d’Octobre à l’occasion de la première conférence des organisations pour l’éveil culturel, tenue à Moscou du 23 au 28 février 1918. Le texte original émanait de l’Association pour l’éducation libre et avait été dévoilé au congrès Prolet’cult. Malheureusement, le Parti communiste se montra très vite extrêmement méfiant envers de telles initiatives.
Une autre déclaration avait été adoptée par la conférence conjointe de l’Internationale des jeunes travailleurs et de l’Internationale de l’union des jeunes socialistes, qui s’était tenue à Salzbourg le 21 août 1922. Cette déclaration s’intitule Programme de revendications immédiates, mais elle est souvent appelée Déclaration des droits de l’adolescent. Les deux organisations élaborèrent « un programme minimal pour la protection de la jeunesse ». Eglantyne Jebb connaissait cette déclaration : George Werner[52], qui avait été le président de l’Union internationale de secours aux enfants de 1921 à 1923 et son vice-président de 1923 à 1929, l’aida en 1924 avec Etienne Clouzot à donner à la Déclaration de Genève « sa forme finale ».
Le Conseil International des Femmes était un organisme-cadre pour les mouvements féministes. Eglantyne Jebb était en contact régulier avec l’une de ses dirigeantes, l’écossaise Ishbel Hamilton-Gordon, marquise d’Aberdeen et de Temair – présidente du Comité de 1893 à 1936. À la conférence du Comité International des Femmes tenue en Norvège en 1920, les Conseils des Femmes d’Italie et des États-Unis présentèrent des résolutions demandant au Comité d’élaborer une charte de l’enfant. Un comité fut désigné pour élaborer un projet et en 1922 ses membres se réunirent à La Haye. Les résultats de leurs travaux furent présentés à l’exécutif du Conseil International des Femmes et aux conseils nationaux. La charte était un document volumineux : elle comprenait sept sections, divisées chacune en un nombre substantiel de paragraphes. Le premier paragraphe s’ouvrait sur cette phrase forte : « Cette charte repose sur le principe que chaque enfant naît avec le droit inaliénable d’avoir l’opportunité de se développer pleinement sur le plan physique, mental et spirituel »[53].
Eglantyne Jebb pensait que cette Charte de l’Enfant était trop détaillée et estimait qu’elle ressemblait à « une liste de règles standard minimum » plutôt qu’à une « déclaration de principes fondamentaux »[54]. Cependant, à mon avis, la première phrase de la Charte de l’Enfant du Conseil International des Femmes est davantage rédigée dans le langage des droits que ne l’est la Déclaration de Genève, sur laquelle nous allons désormais nous pencher.
Le mythe et la réalité
Dès leur création, le Save the Children Fund et l’Union internationale de secours aux enfants se sont illustrés dans le domaine des relations publiques et de la construction de mythes. Un des mythes fondateurs est l’histoire suivante : Eglantyne aimait se rendre au Mont Salève, un sommet de neuf-cent mètres situé en France, mais non loin de Genève, d’où l’on a une vue magnifique sur le lac, les montagnes du Jura et même, par temps clair, sur le Mont Blanc. Elle avait déclaré à des amis anglais qu’elle souhaitait que l’Union publie une déclaration, facile à traduire et à comprendre[55]. A son arrivée à Genève en 1922, Eglantyne entraîna Etienne Clouzot, le secrétaire général, loin de son bureau, dans un petit restaurant au sommet du Mont Salève où elle lui fit part de ses projets. Clouzot fut convaincu et ils se mirent immédiatement à ébaucher un projet. Je ne doute pas qu’il y a de nombreux endroits bucoliques dans les environs de Genève, mais même s’il s’avérait qu’Eglantye Jebb a organisé une rencontre au Mont Salève pour esquisser la Déclaration de Genève, cela ne ferait que révèler un trait narcissique de sa personnalité. Cet épisode fait penser au récit biblique de Moïse se retirant sur le mont Sinaï pendant quarante jours et quarante nuits pour y recevoir les Dix Commandements.
L’histoire est belle. Mais en réalité, une première ébauche de la Déclaration de Genève parut dans le Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants le 30 octobre 1922. Mulley écrit qu’Eglantyne Jebb avait proposé que l’Union adopte « un document définissant les devoirs des adultes envers les enfants que chaque pays devrait adopter soit par le biais d’une action de l’État, soit par une initiative privée »[56]. En outre Moody, citant les archives de l’Union, souligne qu’à l’automne 1922, un processus de consultation avait eu lieu pour élaborer une introduction au texte de la Charte de l’Enfant Jebb écrivit : « Si nous voulons […] continuer à travailler dans l’intérêt des enfants […] la seule façon de le faire semble être d’évoquer un effort de coopération des nations pour protéger leurs propres enfants suivant une ligne constructive plutôt que charitable. Je crois que nous devrions revendiquer certains droits pour les enfants et travailler à leur reconnaissance universelle[58]. »
Le processus de consultation déboucha sur plusieurs ébauches d’« une sorte de Déclaration des droits de l’enfant »[59]. Une version en particulier commença à circuler, elle comportait sept points. Jebb avait du mal à obtenir des retours sur ce texte et trouvait cela parfois frustrant. La marquise d’Aberdeen et de Temair, qui était aussi membre du conseil de l’Union, proposa que la charte du Conseil International des Femmes remplace celle de l’Union[60]. D’après Mulley, Lady Aberdeen désapprouvait la charte de l’Union qui était plus courte. Toutes ces consultations donnèrent à Jebb l’impression qu’elle devait faire trop de concessions. D’après Mulley, quand Jebb présenta A Children’s Charter. A Declaration of the Rights of Childhood en janvier 1923, elle eut le sentiment que les articles originaux avaient été trop édulcorés et lui préféra la Charte de l’Enfant de Lady Aberdeen[61]. Lorsque Jebb se vit proposer de présenter le projet de déclaration devant l’assemblée de l’Union internationale de secours aux enfants pour approbation, elle saisit sa chance et révisa le document avec l’aide de son allié Etienne Clouzot (qui comme mentionné plus haut fut secrétaire général de l’Union de 1921 à 1929) ainsi que celle de Georges Werner[62]. Elle fit ensuite traduire leur texte en français[63]. Selon Mulley, après maintes consultations, la déclaration fut « finalement approuvée » à la 4e assemblée générale de l’Union, le 17 mai 1923[64]. La version française de la Déclaration de Genève fut adoptée par l’Union en février 1923. Il est donc correct de dire que la Déclaration de Genève a d’abord été adoptée par l’assemblée générale de l’Union et que la Société des Nations lui a emboîté le pas en 1924[65]. Une affiche belge mentionne les deux dates : le 23 février 1923 pour l’adoption de la déclaration par l’assemblée générale de l’Union internationale de secours aux enfants et le 17 mai 1923 pour son adoption par le Comité exécutif de l’Union. Un événement fut organisé le 28 février 1924 pour marquer la signature de la version française du document par des personnalités importantes de l’Union.
Eglantyne Jebb proposa de nommer le document « Déclaration de Genève », ce qui plut assurément à Gustave Ador et à tous ceux qui œuvraient pour « l’esprit de Genève » et pour la promotion de la ville au rang de « cité des organisations internationales ». Il y avait sans doute aussi une autre raison de nommer le texte « Déclaration de Genève » : cela lui conférait une certaine neutralité et je ne fais pas ici allusion à la neutralité suisse. Des membres du Save the Children Fund s’étaient opposé à l’intitulé « Déclaration des droits de l’enfant », trouvant qu’il y était trop question de droits. Le terme « Déclaration » était aussi moins fort – et donc plus acceptable – que celui de « Charte ».
Toutefois, lorsque la déclaration fut adoptée par la Société des Nations, le président de l’Assemblée, Giuseppe Motta, déclara : « L’approbation de la déclaration par l’Assemblée en fait, pour ainsi dire, la Charte des enfants de la Société »[66]. Étant donné que de nombreux membres du Conseil général de l’Union avaient des liens avec le Comité International de la Croix Rouge, il n’est pas non plus inutile de souligner qu’ils devaient apprécier l’association qui pouvait être faite avec les Conventions de Genève. Moody explique que Jebb avait d’ailleurs envisagé d’ajouter la Déclaration de Genève aux Conventions de Genève[67]. Mais l’idée fut abandonnée car jugée irréaliste.
Faire connaître la Déclaration de Genève
L’article 42 de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989, stipule que « Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants ».
Même si la Déclaration de Genève ne contenait pas de telle recommandation, l’Union internationale de secours aux enfants qui excellait dans la communication, lança immédiatement une campagne de relations publiques. J’ai déjà mentionné que le 28 février 1924, des signatures furent ajoutées à la déclaration à l’occasion d’une cérémonie solennelle au Musée d’art et d’histoire de Genève. De nombreux diplomates et représentants d’organismes internationaux étaient présents et un exemplaire de la Déclaration de Genève fut signé par les membres de l’Union internationale de secours aux enfants. L’événement fit grand bruit et de nombreux journaux à travers le monde en parlèrent.
L’une des histoires les plus émouvantes alors relayées est celle de Gustave Ador, le premier signataire de la déclaration au Musée d’art et d’histoire, lisant la Déclaration depuis la Tour Eiffel, le 21 novembre 1923, dans le cadre d’un programme radiophonique[68]. J’ai tenté sans succès d’obtenir plus d’informations au sujet de cette émission auprès de Radio France. Mais alors même que je me demandais s’il ne s’agissait pas d’une légende, le Comité International de la Croix-Rouge m’a envoyé une photo montrant le baron de Geer aux côtés de Gustave Ador dans le studio, lors de l’enregistrement.
La plus grande avancée : l’adoption par la Société des Nations
D’après Dominique Marshall « il y avait une grande incertitude autour de la Déclaration et de ses auteurs au sein de la Société des Nations »[70]. Plusieurs projets concurrents étaient ébauchés au même moment. En 1919, l’Organisation internationale du Travail avait adopté une convention fixant l’âge minimum pour l’embauche des enfants dans l’industrie ainsi qu’une convention sur leurs conditions de travail de nuit. Marshall rapporte également que les membres du Secrétariat social de la ligue étaient au courant que le Conseil International des Femmes avait adopté une Charte de l’Enfant en 1920. L’Union internationale de secours aux enfants, toujours selon Marshall, « espérait tenir le premier rôle dans la rédaction d’un projet définitif qui pourrait être adopté par tous les pays »[71]. « C’est semble-t-il l’accent mis sur un document rédigé en termes simples qui semble avoir donné l’avantage à la [déclaration de Jebb] dans cette compétition, […] Soumettre la déclaration à la Société des Nations, était dans la droite ligne de l’une des stratégies de l’UISE [l’Union internationale de secours aux enfants] visant à conférer de la “légitimité” à sa charte[72] ».
L’époux de Dorothy Buxton, Charles, était alors l’un des représentants de la Grande-Bretagne à la Société des Nations. Le fait que le Premier ministre britannique Ramsay MacDonald (à la tête d’un gouvernement travailliste minoritaire en 1924) était présent à Genève s’avéra tout aussi décisif. Les excellentes relations qu’Eglantyne Jebb entretenait avec Gustave Ador mais aussi avec l’ancien président de la Confédération suisse, Giuseppe Motta, qui en 1924 présidait la Société des Nations, se révélèrent également payantes. C’est Motta qui, avec le soutien de Ramsay MacDonald, fit en sorte que la déclaration soit soumise à l’appréciation de la commission de la Société des Nations chargée de la protection de l’enfance. L’action coordonnée d’Eglantyne Jebb et de ses alliés s’avéra efficace : en approchant Jorges Valdes Mendeville, le représentant chilien à la Société des Nations, ils s’assurèrent que la proposition émanait d’une personnalité neutre et la déclaration fut votée à l’unanimité. « L’Assemblée adopte la Déclaration des Droits de l’enfant, communément appelée Déclaration de Genève et invite les États membres de la Société des Nations à observer ses principes pour l’établissement du bien-être des enfants[73]. »
Cependant je ne voudrais pas donner l’impression qu’à Genève tout le monde partageait le même enthousiasme à l’égard de la Déclaration de Genève. Eglantyne Jebb était une lobbyiste douée, qui avait fait circuler le projet de texte dans trente-sept langues et qui carburait à la « vitamine R » – c’est-à-dire grâce à ses nombreuses relations. Marshall écrit que l’adoption rapide et unanime de la Déclaration de Genève « a été favorisée par la domination exercée par la Grande-Bretagne sur les différentes agences de la Ligue »[74]. Marshall est d’avis que « l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant, en septembre 1924, était grandement due à l’influence britannique et à des considérations élitistes »[75] et ajoute plus loin : « En 1922 le Département social du Secrétariat avait tendance à rejeter l’UISE [l’Union internationale de secours aux enfants], considérée comme inefficace et inutile. Une fois que l’action d’urgence contre la famine était devenue moins pressante, l’avis était que l’organisation était devenue sans objet[76] ». Marshall souligne que les efforts « neutres » d’Eglantyne Jebb étaient perçus comme liés aux intérêts politiques britanniques, même si certains l’oublient aujourd’hui. C’est bien son adoption par la Société des Nations qui donna son importance à la Déclaration de Genève et non la cérémonie de signature du 23 février 1923, ni la proclamation diffusée depuis la tour Eiffel.
Le contenu de la Déclaration
Le préambule de la Déclaration déclare que « les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l’Humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur ». Par « ce qu’elle a de meilleur », il fallait entendre sa promptitude à subvenir à « ces besoins de l’enfant devant être satisfaits à tout prix, même en période de tension économique »[77]. Comme Geraldine van Bueren le nota elle aussi, la Déclaration de Genève « n’a jamais eu pour but de créer un instrument imposant aux États des obligations contraignantes. Le devoir fait à l’humanité de procurer à l’enfant “ce qu’elle a de meilleur”, incombait aux hommes et aux femmes. Il revenait donc aux adultes d’assurer le bien-être des enfants »[78]. Aujourd’hui, un rôle plus important est dévolu aux États. La CIDE par exemple a été principalement ratifiée par ces derniers. Au moment de la rédaction de la Convention de Genève, les enfants étaient considérés comme « des bénéficiaires d’actions en leur faveur plutôt que des détenteurs de droits particuliers », comme l’observe Geraldine van Bueren[79]. Chanlett et Morier ajoutent que « dans l’absolu, la Déclaration incarne les principes de base du bien-être de l’enfant, laissant à chaque pays le soin de prendre les mesures appropriées, en fonction de ses besoins et ressources »[80].
Bruno Cabanes analyse la rédaction de la Déclaration de Genève avec un regard plus critique : « La Déclaration de 1924 est à situer clairement dans le contexte de l’après-guerre, durant lequel les enfants étaient au cœur de tous les efforts de paix et de reconstruction, précisément parce que leur sort dépassait les frontières nationales. La question des droits de l’enfant était par essence transnationale. L’enfant en tant que figure universelle, inventée, à laquelle tous les signataires de la Déclaration de 1924 adhéraient et souscrivaient, était considéré comme un être apolitique capable d’unifier les efforts de paix. Les enfants étaient considérés comme les bénéficiaires par excellence de la réconciliation d’après-guerre »[81]. Dans un autre passage, Cabanes exprime cela plus brutalement : « Le culte de l’enfant universel, une fiction élaborée par le droit international, fut répandu en même temps que celui de la neutralité et de l’innocence – des valeurs que la Première Guerre mondiale avait violées avec une extrême brutalité, mais que les fondateurs du Save the Children Fund voulaient encore honorer »[82]. Les recherches de Cabanes et Marshall nous font réaliser que même si le mouvement international pour les droits de l’enfant débuta avec la Déclaration de Genève, il était lié à différents intérêts, notamment à ceux de la Grande-Bretagne qui était toujours une grande puissance coloniale. Le mouvement des droits de l’enfant n’étant pas particulièrement prompt à l’autocritique[83], des travaux de recherche sur son histoire sont plus que jamais nécessaires.
Article 1 de la déclaration établit que « L’enfant doit être en mesure de se développer d’une façon normale, matériellement et spirituellement ». Le Child Study Movement encourageait la recherche sur l’enfant et son développement[84]. Le brouillon de la Déclaration qui circula en 1922 disait : « Tout enfant doit être mis en mesure de se développer normalement au physique comme au moral », une formulation qui aurait soulevé des questions éthiques sur ce qui est « normal ».
Lors d’un échange avec une militante néerlandaise des droits de l’enfant[85], je lui ai demandé si elle considérait que les cinq principes de 1923 étaient toujours pertinents. Elle a été émue par le fait que l’article 1er concernait le développement de l’enfant. Elle a immédiatement fait le lien avec les préoccupations actuelles aux Pays-Bas au sujet de la santé mentale des jeunes et du nombre croissant d’entre eux qui ont des idées suicidaires.
Il est également intéressant de noter que si aujourd’hui nous nous préoccupons de la santé mentale des jeunes, nous ne donnons plus la priorité au développement spirituel de l’enfant[86]. Cette préoccupation a été reléguée au paragraphe I de l’article 27 de la CIDE et corrélée au niveau de vie[87].
Article 2 porte lui aussi sur les devoirs de la collectivité envers l’enfant : « L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant qui est malade doit être soigné ; l’enfant arriéré doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’orphelin et l’abandonné doivent être recueillis et secourus ».
En 1927, Jebb fit remarquer que par le passé, la priorité était donnée aux enfants qui étaient les plus utiles à la communauté et que l’article 2 établissait donc une nouvelle norme morale[88]. Les clauses sur lesquelles s’ouvrent l’article 2 ont trait aux conditions matérielles et à la santé. Le terme « arriéré » renvoie probablement à l’enfant atteint d’un handicap mental. Edward Fuller a expliqué que la mise en œuvre de cet aspect de l’article a souvent été contrariée par le manque de fonds, puisqu’en 1924 l’action sociale était en grande partie financée par des dons privés[89].
Le principe voulant que l’enfant ayant des démêlés avec la justice ne soit pas seulement puni, mais aussi accompagné et réinséré était nouveau à cette époque. Les tribunaux pour mineurs étaient un concept récent. Le premier avait été mis en place à Chicago en 1898.
Article 3 stipule que « L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse ».
Bruno Cabanes considère que l’article 2 est le plus important, « dans la mesure où, comme le préambule, il légitimise l’existence des droits propres à l’enfant en vertu de sa place dans la société. […]. L’expérience de la Grande Guerre et le symbole de l’enfant martyr qui en découla, impactèrent durablement la Déclaration des droits de l’enfant »[90]. Fuller explique que ce principe n’est pas seulement important en temps de guerre « mais doit toujours avoir la priorité »[91]. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les gens savaient ce qu’étaient les « temps de détresse ». Ils pouvaient en revanche se demander à qui il revenait de financer les secours en de telles périodes. La déclaration n’apporte aucune réponse à ce sujet. Son préambule est adressé à « des hommes et des femmes de toutes les nations » mais pas aux États. En obtenant la reconnaissance de la Déclaration par la Société des Nations, l’Union internationale de secours aux enfants réussit cependant à « s’immiscer parmi les États et à établir une sorte de connivence »[92].
Nos enfants vivent eux aussi aujourd’hui « des temps de détresse ». A l’heure où j’écris, un an s’est écoulé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, le début d’une guerre civile au Soudan et l’attaque terroriste du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023, suivie par la guerre avec le Hamas à Gaza et maintenant, la famine à Gaza[93]. Parfois, les enfants sont les premières cibles, comme en Ukraine, et on peut se demander si l’aide leur parvient réellement. Les ministères des Affaires Étrangères et de la Coopération des États qui fournissent des aides ou participent au financement d’actions humanitaires n’ont souvent même pas de politique centrée sur la question des enfants. L’article 3 est donc toujours d’actualité.
Quoi qu’il en soit, bien que la Déclaration de Genève donne l’impression de traiter des Droits de l’enfant en tout temps, cet article montre qu’il est en réalité axé sur leurs droits en temps de guerre et au lendemain à celles-ci. C’est compréhensible, étant donné que la Déclaration a été rédigée quelques années à peine après les horreurs de la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, nous valorisons les droits qui favorisent la participation des enfants, mais quand la Déclaration a été rédigée, on attendait de ces derniers qu’ils obéissent. Qu’ils participent à des décisions aurait été considéré comme une fantasmagorie[94]. L’article 12 de la CIDE, qui insiste sur le respect de l’opinion de l’enfant, aurait été impensable en 1923. L’enfant est devenu un sujet actif de droits et non plus un objet passif à protéger par le droit. Depuis sa création, le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant, a rejeté « la mentalité de charité et les approches paternalistes »[95]. Cabanes écrit : « En plaçant explicitement les enfants sous la protection des adultes, le texte de la Déclaration dessine le schéma d’une société idéale où le plus faible peut vivre en sécurité, à l’abri du besoin. Les enfants étaient considérés comme des êtres fragiles et innocents qu’il fallait protéger, surtout “en temps de détresse”. Les enfants n’étaient pas considérés comme des sujets de droit ou comme de futurs citoyens. L’accent était mis sur leurs droits sociaux et sur l’obligation faite aux adultes “de les nourrir, prendre soin d’eux, les protéger et les éduquer, en particulier lorsqu’ils ont faim, qu’ils sont malades ou en danger’’[96]. »
Dans un journal néerlandais, j’ai lu un article très touchant sur une sage-femme d’Amsterdam qui, en réaction au tremblement de terre en Turquie, s’est mise à collecter des biens de première nécessité, des couches pour bébés par exemple. Le titre de l’article demandait : « Qui pense aux plus petits[97] ? ». Cette action est totalement dans l’esprit de l’article 3 de la Déclaration de Genève. Mais il y a des difficultés. Comme l’a dit Mike Aaronson[98], ancien directeur exécutif de Save the Children UK : « Les enfants devraient être les premiers à recevoir de l’aide. Mais nous ne pouvons pas leur accorder une aide spéciale sans tenir compte de facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques plus larges. »
La déclaration ne contenait alors aucun article de non-discrimination tel que l’article 2 de la CIDE. Le brouillon de 1922 (celui qui comportait sept articles plutôt que cinq) en contenait un lui : « L’enfant doit être secouru en dehors de toute considération de race, de nationalité et de croyance[99] ». Là où l’article 3 évoque « L’enfant », nous devrions peut-être lire : « Tout enfant, sans discrimination »[100]. C’est sans doute ce qu’aurait voulu Jebb, qui souhaitait que la Déclaration de Genève soit universelle[101]. Toute la philosophie à l’origine du Save the Children Fund était ancrée dans l’idée fondamentale qu’il fallait aussi aider les autres, comme les bébés autrichiens pour lesquels Eglantyne Jebb manifesta à Trafalgare Square.
Article 4
« L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé contre toute exploitation ».
On ne voit plus du tout les choses de la même manière aujourd’hui où l’accent est davantage mis sur la possibilité pour l’enfant de vivre une vraie vie d’enfant. L’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant met l’accent sur le droit aux loisirs, aux jeux et à l’accès à la culture. « Gagner sa vie » pourrait être compris comme une validation du travail des enfants. Dans l’une des ébauches de la Déclaration de Genève qui passèrent entre les mains des membres de l’Union, l’un des sept articles stipulait : « Le travail de l’enfant sera protégé partout, en particulier contre toutes les formes d’exploitation »[102]. Je suis heureux que cet article n’aie pas été inscrit dans la version finale, car il aurait entravé les efforts pour parvenir à de meilleures règles sur l’âge minimum d’accès à l’emploi. Il a tout de même fallu attendre 1973 pour que la convention n° 138 de l’Organisation internationale du Travail soit adoptée[103].
L’article 4 dit que l’enfant doit être considéré comme un individu libre, dont le but dans la vie n’est pas d’être au service des autres. La deuxième partie de l’article cible l’esclavage, la prostitution et le trafic de mineurs. Nous devons cependant aussi replacer cet article dans le contexte de l’Empire colonial britannique, où les enfants étaient encouragés à apprendre un métier manuel, comme la menuiserie. Le Save the Children Fund finança de nombreux projets de ce type. L’Union internationale de secours aux enfants organisa aussi une conférence internationale sur les enfants africains en juin 1931. On notera que seuls cinq Africains y participèrent. J’ai pu constater que la décolonisation des droits de l’enfant n’est devenue un sujet à part entière qu’au cours de ces dernières années[104]. Des enquêtes ont été ouvertes en Australie et au Canada sur les atrocités commises dans des pensionnats pour enfants autochtones. Le militant des droits de l’enfant aux Pays-Bas qui m’a aidé à analyser les articles de la Déclaration de Genève m’a fait remarquer que ses auteurs avaient reporté sur les enfants bon nombre de problèmes de la société[105].
Article 5
« L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mises au service de ses frères ».
Bruno Cabanes estime que l’article 5 est plus un idéal qu’un droit au sens strict du terme, dans l’esprit caractéristiques des débuts de la Société des Nations[106].
Fuller observait en 1951 que l’article 5, tout comme le préambule de la déclaration, « se démarque par sa qualité universelle » (c’est moi qui souligne)[107]. Aujourd’hui, cet article entre en conflit avec les idées nationalistes sur l’éducation. Comme je l’écrivais en 1992, le fait d’avoir des ennemis bat en brèche l’universalisme des droits de l’enfant »[108]. Ce principe ressemble au paragraphe 1(b) de l’article 29 de l’actuelle Convention des droits de l’enfant qui définit les objectifs de l’éducation : « Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ». Et dans le paragraphe 1(a) de ce même article 29 des droits de l’enfant il est question de « ses dons et de ses aptitudes », une formulation qui fait penser à « ses meilleures qualités », invoquées dans l’article 5 de la Déclaration de Genève. Le paragraphe 1(a) dit : « Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ».
Avons-nous fait des progrès depuis la Déclaration de Genève ?
Avec la publication de la Déclaration de Genève il y a cent ans, le concept général des droits de l’enfant devint pour la première fois un sujet de débat dans une organisation intergouvernementale[109]. Cela a permis de donner une plus grande visibilité aux droits de l’enfant. Mais, la conceptualisation des droits de l’enfant a beaucoup changé depuis, en particulier depuis 1948, en raison des débats qui ont eu lieu dans les institutions des Nations Unies chargées des droits de l’Homme. En 1924, l’enfant était perçu comme un être en besoin de protection et comme un objet de droits. Depuis l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, il est devenu un sujet de droits, dont l’opinion doit être entendue.
Les enfants n’ont pas été consultés lorsque leurs droits ont été formulés en 1923. Ils ne l’ont lu pas plus été entre 1978 et 1989, quand la Convention des droits de l’enfant a été débattue aux Nations Unies. Ce n’est qu’en juillet 2024 que le groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer un Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant[110] a été invité à « assurer la participation significative d’enfants […] et en particulier, de donner aux enfants l’opportunité d’exprimer leurs points de vue sur le sujet du Protocole Optionnel proposé […] »[111]. La participation d’enfants et d’adolescents est enfin prise au sérieux dans l’élaboration des droits de l’homme qui les concernent.
Les droits à la participation sont certes importants, mais nous n’avons même pas encore réussi à mettre en œuvre l’article 2 de la Déclaration de Genève : « L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant qui est malade doit être soigné ». Comme l’écrit Alex de Waal :
Dans des pays comme l’Afghanistan, le Yémen, l’Éthiopie, Haïti et surtout le Soudan, des hommes armés ne tiennent aucun compte des droits et des principes humanitaires. Par choix ou par imprudence, ils affament des enfants et des mères, ce qui a des conséquences catastrophiques. La guerre est depuis longtemps cause de famines et, ces dernières années, des diplomates et des juristes ont cherché à renforcer l’arsenal juridique international visant à combattre celles-ci, notamment par un amendement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale criminalisant la famine dans des conflits armés non-internationaux et par une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU introduisant de nouvelles mesures pour agir rapidement lorsqu’un conflit armé risque de causer une crise alimentaire. Toutes ces mesures visent des obligations humanitaires qui ne sont pas respectées au niveau mondial[112].
Un changement s’est produit lorsque la Déclaration de Genève a été débattue à la Société des Nations en 1924. Le concept d’enfant qui était alors purement caritatif est devenu plus politique. Alors que les enfants étaient à l’origine considérés comme des objets de charité, Eglantyne Jebb a découvert que la tribune politique qu’offrait la Société des Nations, comme plus tard les Nations Unies[113], était un moyen de faire avancer la question des droits et du bien-être de l’enfant.
Stanley Cohen estimait que les gens qui refusent de détourner le regard devant les atrocités ou la souffrance humaine partagent « le sentiment d’appartenir à une humanité commune […] s’ils n’aident pas, ils éprouvent un profond sentiment de honte pour leur passivité »[114]. Eglantyne Jebb et sa sœur n’ont pas détourné le regard. La Déclaration de Genève a fait avancer l’idée d’humanitarisme universel. Pourtant, comme l’écrivait Cohen, nous détournons le regard alors que la télévision et les réseaux sociaux font entrer les atrocités perpétrées contre les enfants dans nos foyers et nos smartphones.
L’humanitarisme discriminatoire se porte bien lui aussi. En févier 2023 la BBC rapportait par exemple que le régime syrien avait finalement donné son accord pour que l’aide humanitaire parvienne dans toutes les parties du pays touchées par le tremblement de terre[115]. Il s’opposa toutefois à l’ouverture des postes-frontières qui auraient permis d’acheminer l’aide à ceux qu’il considérait comme des rebelles. Stephen Hopgood, qui a étudié l’humanitarisme et l’ordre international post-libéral pose ces questions : « Le fait de traiter tout le monde de la même manière ou en fonction de ses besoins doit-il être une exigence pour toutes les formes d’action humanitaire ? Si tel est le cas, ne sommes-nous pas astreints au respect de la règle la plus fondamentale de l’ordre libéral : la non-discrimination[116] ? » Lui-même pense que le respect de cette règle est lié à la version « ordre-du-monde-libéral » de l’action humanitaire »[117]. Je crois qu’il vaut la peine de se battre pour celle-ci. Mais livrons-nous une bataille déjà perdue ? La lecture de Hopgood ne m’a pas rendu optimiste : les « fondements des normes libérales universelles et de la gouvernance globale sont en train de s’écrouler » constate-t-il, ajoutant : « Ce qui semblait être une aurore est en fait un coucher de soleil[118]. »
Avec le retour de la guerre en Europe, un Proche-Orient au bord de l’abîme, une Chine de plus en plus puissante, le changement des rapports de force mondiaux et la montée des régimes dictatoriaux, le principe d’universalisme que la Déclaration de Genève avait contribué à diffuser est désormais en danger. Des signes indiquent que la Chine cherche à élaborer une alternative au modèle des droits humains, centrée non pas sur l’universalisme, mais le « développement des États » et la reconnaissance des différences culturelles[119]. Pas étonnant que les droits des enfants soient en « polycrise »[120].
Dans ce contexte, la Déclaration de Genève et la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que ses Protocoles facultatifs élaborés sur la base de la Déclaration de Genève sont plus importants que jamais. Dans les années 1989-2010, nous étions grisés par le succès de la Convention internationale des droits de l’enfant. Celle-ci a été ratifiée par la quasi-totalité des États de la planète. Mais désormais, il semble que nous naviguions à contre-courant. Pour beaucoup, les principes de l’humanitarisme et de l’universalisme qui sous-tendent la Déclaration de Genève, tout comme les obligations découlant du droit international humanitaire et des droits humains sont des lueurs d’espoir. Cent ans après l’adoption de la Déclaration de Genève par la Société des Nations, il est devenu évident que nous devons continuer à nous battre pour ces principes et pour les droits formulés en 1989 dans la Convention internationale des droits de l’enfant.
Footnotes
[1] Ce chapitre est l’adaptation d’une conférence donnée à Luxembourg le 23 février 2023. L’événement, qui marquait le centenaire des Droits de l’enfant, était organisé par l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher zu Lëtzebuerg. Je remercie le médiateur, M. Charles Schmit, de m’avoir permis de m’exprimer à l’occasion du centième anniversaire de la Déclaration de Genève.
[2] Société des Nations, Déclaration internationale des droits de l’enfant (1924), http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm.
[3] Il existe une autre « Déclaration de Genève », portant sur les principes éthiques en matière de médecine, adoptée à Genève en 1948 par la World Medical Association.
[4] Eric Alterman, « The Decline of Historical Thinking », The New Yorker, 4 février 2019.
[5] Bas Heijne, « Schaf geschiedenis niet af », NRC, 21 mai 2016,
https://www.nrc.NL/Niews/2016/05/21/schaf-gegeshiedenis -niter-af-1619496-a377750.
[6] Willem Koops, « Het kind als de Spiegel der beschaving », Studium Generale Magazine 2(2013) : 26-28.
[7] Philip Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood (Martinus Nijhoff, 1992).
[8] Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, (Plon, 1960).
[9] John Tobin, The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary (Oxford University Press, 2019), 34–37.
[10] Tobin, UN Convention on the Rights of the Child, 36.
[11] Joelle Droux, « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900–1925) », Critique Internationale 3, n°52 (2011) : 17–33.
[12] Veerman, Rights of the Child. Cf. Chapitre 6 (« Eglantyne Jebb: The World is My Country ») et Chapitre 10, §1 (« The Declaration of Geneva »).
[13] Francesca M. Wilson, Rebel Daughter of a Country House: The Life of Eglantyne Jebb, Founder of The Save the Children Fund, (George Allen and Unwin, 1967).
[14] Philip Veerman, « Janusz Korczak and the Rights of the Child », Concern 62 (1987) : 7–9.
[15] Clare Mulley, The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb, (OneWorld, 2009).
[16] Philip Veerman, « In the Shadow of Janusz Korczak: The Story of Stefania Wilczynska »,
The Melton Journal 23 (Printemps1990) : 8–9. Mme Stefa soutenait Korczak et veillait à ce que l’orphelinat fonctionne comme une montre suisse.
[17] Mulley, Woman Who Saved the Children, 303.
[18] Mulley, Woman Who Saved the Children, 303.
[19] « Eglantyne Jebb – The Victorian Activist! », HistoryWorks, http://www.creatingmycambridge.com/history-stories/eglantyne-jebb/.
[20] Cf. Linda Mahood, « Feminists, Politics and Children’s Charity: The Formation of the Save the Children Fund », Voluntary Action 5, n° 1 (2002) : 71-88.
[21] Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover. Years of Adventure. 1874–1920, (MacMillan, 1952), 257. Cf. aussi : Dominique Marshall, « Children’s Rights and Children’s Action in International Relief and Domestic Welfare: The Work of Herbert Hoover Between 1914 and 1950 », Journal of the History of Childhood and Youth 1, n° 3 (2008) : 351-388.
[22] Hoover, Memoirs, 337.
[23] New Tactics in Human Rights, https://www.newtactics.org.
[24] Gillian Wilson, « The White Flame », World’s Children (septembre 1976): 6.
[25] Jean-Georges Lossier, « Tribute to the memory of Eglantyne Jebb », International Review of the Red Cross (1976) : 543–551.
[26] Depuis mars 2021, il existe un parc Eglantyne Jebb au cœur de Genève. Le 7 février 2024, ses ossements furent exhumés et solennellement enterrés au Cimetière des Rois à Genève, réservé aux dignitaires qui ont fait la notoriété de la ville. Des membres du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies prononcèrent des discours à l’occasion de la cérémonie.
[27] Emily Baughan, Saving the Children: Humanitarianism, Internationalism, and the Empire (University of California Press, 2021).
[28] Emily Baughan et Juliano Fiori, « Save the Children, the Humanitarian Project, and the Politics of Solidarity: Reviving Dorothy Buxton’s Vision », Disasters 39, n° 2 (2015) : 129–145.
[29] Wilson, Rebel Daughter of a Country House.
[30] Mulley, Woman who Saved the Children.
[31] Waltraut Kerber-Ganse, « Eglantyne Jebb – A Pioneer of the Convention on the Rights of the Child », International Journal of Children’s Rights 23, n° 2 (2015) : 272–282.
[32] Wilson, « White Flame », 6.
[33] Veerman, Rights of the Child, 87–92 et 155–159.
[34] Petà Dunstan, Campaigning for Life: A Biography of Dorothy Frances Buxton, (Lutterworth, 2018).
[35] Baughan et Fiori, « Save the Children », 132.
[36] Victoria Bunsen, Charles Roden Buxton: A Memoir, (George Allen & Unwin, 1948).
[37] Charles Roden Buxton, In a Russian Village (The Labour Publishing Company, 1922).
[38] Baughan et Fiori, « Save the Children », 133.
[39] Lara Bolzman, « The Advent of Child Rights on the International Scene and the Role of the Save the Children International Union 1920–1945 », Refugee Survey Quarterly 927, n° 4 (2009) : 26–36.
[40] J’ai trouvé des informations sur le Comité international de secours aux enfants sur LONSEA.org (le moteur de recherches de la Société des Nations).
[41] Mulley, Woman Who Saved the Children, 274.
[42] Shai M. Dromi, Above the Fray: The Red Cross and the Making of the Humanitarian NGO Sector (University of Chicago Press, 2020), 118–119. Ador avait été le président de la Confédération suisse en 1919.
[43] Dominique Marshall, « The Construction of Children as an Object of International Relations: The Declaration of Children’s Rights and the Child Welfare Committee of the League of Nations, 1900–1924 », The International Journal of Children’s Rights 7, n° 2 (1999) : 103–147.
[44] Marshall, « Construction of Children », 104.
[45] Marshall, « Construction of Children », 104. Cf. aussi : Joëlle Droux, « Children and Youth: A Central Cause in the Circulatory Mechanisms of the League of Nations (1919–1939) », Prospects 45, n° 1 (2015) : 63–76.
[46] Linde Lindkvist, « Rights for the World’s Children: Rädda Barnen and the Making of the UN Convention on the Rights of the Child », Nordic Journal of Human Rights 36, n° 3 (2018) : 287–303.
[47] Frans Verhagen, 1923 het jaar van de omslag (Boom uitgeverij, 2022).
[48] Voker Ullrich, Deutschland 1923. Das Jahr Am Abgrund (C.H. Beck, 2023).
[49] Conan Fischer, The Ruhr Crisis, 1923–1924 (Oxford University Press, 2003).
[50] Bolzman, « Advent of Child Rights », 26–36.
[51] Veerman, Rights of the Child, 281, 435–437, 318–319, 438, 325–328 et 439–443.
[52] Georges Werner, « Remise de la “Déclaration de Genève” au Conseil d’Etat de Genève pour les Archives », Revue Internationale de la Croix-Rouge 6, n° 63 (1924) : 155–156. J’ai trouvé les informations concernant Georges Werner et la Save the Children International Union sur LONSEA.org (le moteur de recherches de la Société des Nations). Selon Andrée Morier, « The Declaration of the Rights of the Child », International Review of the Red Cross 26 (1963 : 227–233 (la citation provient de la page 229).
[53] Philip Veerman, Rights of the Child, 439–443.
[54] « How the Declaration Was Born », International Child Welfare Review 7 (1970) : 40.
[55] « How the Declaration », 40.
[56] Mulley, Woman Who Saved the Children, 305.
[57] Zoe Moody, Les Droits de l’Enfant, Genèse, institutionnalisation et diffusion (1924–1989), (Éditions Alphil-Presses universitaires Suisses, 2016), 109-110.
[58] Moody, Les Droits de l’Enfant, 109, 110.
[59] Moody, Les Droits de l’Enfant, 109, 110.
[60] Moody, Les Droits de l’Enfant, 109, 110.
[61] Moody, Les Droits de l’Enfant, 306.
[62] Morier, « Declaration of the Rights of the Child », 229.
[63] Moody, Les Droits de l’Enfant, 111. Moody indique que le comité éditorial était composé de Werner (professeur de droit à l’Université de Genève), Clouzot (directeur de la Revue Internationale de la Croix-Rouge) et William Andrew MacKenzie (trésorier de la CISE). Eglantyne Jebb en était la présidente.
[64] Mulley, Woman Who Saved the Children, 306.
[65] Philip Veerman, « Le jour où les enfants sont devenus sujets », Le Temps, 29 octobre 2012.
[66] Cité par Geraldine van Bueren dans The International Law on the Rights of the Child (Kluwer Academic Publishers/Martinus Nijhoff, 1995), 7.
[67] Moody, Les Droits de l’Enfant, 112.
[68] Selon Georges Werner.
[69] Pierre Descaves, Quand la radio s’appelait « Tour Eiffel »(Table Ronde, 1963).
[70] Marshall, « Construction of Children », 130.
[71] Marshall, « Construction of Children », 131.
[72] Marshall, « Construction of Children ».
[73] Records of the Fifth Assembly, League of Nations Official Journal (1924), §23 ¶179. Cf. aussi : Resolution of the Assembly, 26 septembre 1924, League of Nations Official Journal (octobre, 1924), §21 ¶42–43.
[74] Marshall, « Construction of Children », 133.
[75] Marshall, « Construction of Children », 128.
[76] Marshall, « Construction of Children », 130.
[77] The World’s Children 3, n° 3 (1923), 111. Cf. : Veerman, Rights of the Child, 218 note 22.
[78] Van Bueren, International Law (Martinus Nijhoff, 1995), 7.
[79] Van Bueren, International Law, 7.
[80] Eliska Chanlett et G. M. Morier, « Declaration of the Rights of the Child », International Child Welfare Review 22, nr° 1^(1968) : 4. Charlett et Morier affirment que la déclaration « allait plus loin que la Partie XIII du Traité de Versailles qui mentionnait déjà la protection de la jeunesse dans son Préambule ».
[81] Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918–1924 (Cambridge University Press, 2014), 298.
[82] Cabanes, Great War, 297.
[83] David Kennedy (Harvard Law School) laisse entendre une voix critique dans le domaine des droits de l’Homme. Il est l’auteur de The Dark Side of Virtue: Reassessing International Humanitarianism (Princeton University Press, 2004).
[84] Alexander W. Siege et Sheldon H. White, « The Child Study Movement: Early Growth and Development of the Symbolized Child », Advances in Child Development 17 (1982) : 233–285.
[85] Brigitte Boswinkel, coordinatrice du Dutch Child’s Rights Collective. J’aimerais la remercier pour ces contributions à ce chapitre.
[86] Philip Veerman, « Is Religion a Friend or Foe of Children’s Rights? » dans Droits de l’enfant et croyances religieuses. Autonomie, éducation, tradition, dirs. P.D. Jaffé, N. Langenegger Roux, Z. Moody, Ch. Nanchen, et J. Zermatten (Université de Genève, Institut international des droits de l’enfant, 2019), 80–93.
[87] « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. »
[88] Eglantyne Jebb, International Responsibilities for Child Welfare(Save the Children International Union, 1927), 7.
[89] Edward Fuller, « Great Britain and the Declaration of Geneva », The World’s Children 5, n° 2 (1924) : 57.
[90] Cabanes, Great War, 292.
[91] Fuller, « Great Britain and the Declaration » : 75.
[92] Cabanes, Great War, 295.
[93] Alex De Waal, « Famine in Gaza: An Example of the Global Humanitarian Crisis », The American Journal of Clinical Nutrition 119, n° 6 (2024) : 1 383–1 385.
[94] Philip Veerman et Lesia Kop, « Opinie: Laat kinderen en jongeren zoveel mogelijk meepraten als volwaardige burgers », De Volkskrant, 31 juillet 2004, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laat-kinderen-en-jongeren-zoveel-mogelijk-meepraten-als-volwaardige-burgers~b3d22c88e/.
[95] Comité des droits de l’enfant, Observation générale 1 sur les buts de l’éducation, UN doc. CRC/GC/2001/1.
[96] Cabanes, Great War, 296.
[97] Jeroen Den Blijker, « Wie denkt er aan de allerkleinsten? », Trouw, 15 février 2023, 6.
[98] Michael Aaronson, « Are Children’s Rights History? », LSE blog, 1er avril 2019, http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2019/01/childrens-rights.
[99] Cf. : Moody, Les Droits de l’Enfant, 110.
[100] Moody, Les Droits de l’Enfant, 129.
[101] Moody, Les Droits de l’Enfant, 110.
[102] Elizabeth Faulkner et Conrad Nyamutata, « Decolonisation of Children’s Rights », International Journal of Children’s Rights 28, n° 1 (2022) : 66–88.
[103] « L’âge minimum […] ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans », comme indiqué dans Organisation internationale du Travail, Convention sur l’âge minimum, 26 Juin 1976, n° 138, UNTS 14862, art. 2, ¶3. Il y avait déjà eu des conventions antérieures, comme la Convention sur l’âge minimum dans l’industrie (1919), Convention sur l’âge minimum dans la pêche (1920), la Convention sur l’âge minimum dans les travaux agricoles (1923) ainsi que la Convention sur l’âge minimum pour les soutiers et les chargeurs (1921).
[104] Faulkner et Nyamutata, « Decolonisation of Children’s Rights », 66–88.
[105] Merci à Brigitte Boswinkel pour son aide.
[106] Cabanes, Great War, 293.
[107] Fuller, « Great Britain and the Declaration », 116.
[108] Veerman, Rights of the Child, 397.
[109] Le travail de mineurs a néanmoins fait l’objet de débats au sein de l’Organisation internationale du Travail.
[110] Conseil des droits de l’homme A/HRC/56/L.8/Rev.1, ¶5 (8 Juillet 2024).
[111] Il s’agit d’un protocole facultatif sur les droits à l’éducation préscolaire, à l’enseignement préprimaire gratuit et à l’enseignement secondaire gratuit.
[112] De Waal, « Famine in Gaza », 1 383–1 385.
[113] Des forums internationaux comme l’Union Africaine sont également devenus importants.
[114] Stanley Cohen, States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering, (Polity Press, 2001).
[115] Lyse Doucet, « Crisis upon Crisis: Why it’s Hard to Get Help to Syria after Earthquake », BBC News, 11 février 2003.
[116] Stephen Hopgood, « When the Music Stops: Humanitarianism in a Post-Liberal World Order » Journal of Humanitarian Affairs 1, n° 1 (2019) : 13.
[117] Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights (Cornell University Press, 2013), 1.
[118] Hopgood, Endtimes, 1.
[119] Adviesraad internationale Vraagstukken, Mensenrechten: Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld (Advisory Council for International Affairs, 2022).
[120] Ann Marie Skelton, International Children’s Rights in Polycrisis: Interconnected Pathways to Social Justice and a Sustainable Future, (Leçon inaugurale, Université de Leiden, 12 avril 2024).