Après des études d’histoire et de lettres (latin, littérature allemande) à Fribourg-en-Brisgau, Simone Beck a enseigné au Lycée Michel Lucius et à l’Athénée de Luxembourg. Elle a interrompu sa carrière d’enseignante en 1993 pour assumer la responsabilité de la communication et de la coordination des projets internationaux dans le cadre de Luxembourg Capitale européenne de la culture 1995. Quelques années plus tard, elle est devenue codirectrice de l’Institut Pierre Werner. Simone Beck est présidente de la Commission luxembourgeoise pour l’UNESCO depuis 2015 et coordinatrice de ons stad, le magazine culturel de la Ville de Luxembourg.he Child.
« Les cas avérés de crimes contre les enfants dans les zones de conflit sont affolants, mais ces chiffres ne font qu’effleurer la surface. On estime que 473 millions d’enfants – soit 19 % des enfants dans le monde – vivent dans des zones de conflit, et chacun de ces enfants a une histoire et une expérience de conflit qui lui sont propres »[1].
– Save the Children
Pour la plupart des téléspectateurs et des consommateurs de médias sociaux, les noms de Gaza, Yémen, Ukraine, Soudan, Haïti ou encore Syrie évoquent des champs de ruines ou d’infinis camps de réfugiés. Les cieux nocturnes sont éclairés par des trajectoires de missiles ou des explosions d’infrastructures vitales pour les populations locales. Dans d’autres reportages, nous voyons des régions desséchées dont le sol aride ne permet plus la plus infime agriculture, avec des êtres humains hagards, au regard éteint. Les caméras montrent des hommes qui déblayent, qui protestent, qui s’expriment devant les caméras ou qui posent en vainqueurs, brandissant armes et drapeaux. Des femmes, des hommes ou des enfants sont étendus sur des lits d’hôpital, blessés, amputés. Les caméras ne peuvent pas montrer l’infinie détresse que ces conflits ou ces régions ravagées par des catastrophes naturelles imposent aux populations civiles. Les parents sentent les menaces peser sur leurs enfants qui n’ont plus d’abri. Comment protéger sa fille dans un camp fait de tentes qu’elle doit traverser la nuit à la recherche des toilettes ? Comment éviter que son garçon ne se fasse enrôler comme soldat ? Comment protéger les femmes contre les violences physiques dont, même dans un pays en paix, elles ne sont pas à l’abri ? Comment se procurer nourriture et eau quand il n’y en a pas ? Et ceci ne sont que des soucis du court terme. Quel avenir attend ces hommes, ces femmes, ces enfants qui doivent vivre dans un cauchemar quotidien ? Le sort des enfants qui souvent sont orphelins, en fuite, déplacés, enrôlés, menacés par des violences sexuelles doit nous préoccuper ici.
En 2023, 460 millions d’enfants vivaient dans des zones de conflit et 43,3 millions en déplacement forcé ; selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), « ce chiffre a doublé en l’espace d’une décennie, et surtout, est le plus élevé jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale[2] ». Depuis 2013 donc, des États – en très grande partie membres des Nations Unies, dont ils ont sinon ratifié ou du moins signé toutes les conventions concernant les droits des enfants – ont réussi à faire doubler le nombre des enfants contraints d’abandonner un cadre de vie qui leur garantissait sécurité et équilibre. Des conflits qu’ils ne comprennent pas exposent ces enfants à des menaces auxquelles leurs familles ne sont pas préparées. Le manque de nourriture, d’eau, d’infrastructures hygiéniques va de pair avec la perte d’un cadre de vie régulier : école, aire de jeux, repas en famille, détente et sommeil. Cette vie est remplacée par un déplacement constant, une perte de repères, des menaces physiques, des mariages de mineures ou encore des enrôlements comme enfants soldats. Il ne faut pas avoir des talents poussés de clairvoyance pour deviner que ces crimes commis envers un demi-milliard de jeunes êtres humains génèrent des générations grandissant dans un environnement de désolation, de destruction et de haine, sentiment qu’ils risquent de transmettre à leurs enfants. Les bébés nés de mariages forcés ou de viols ne connaîtront guère un cadre familial sécurisant et deviendront des victimes faciles, les jeunes dépourvus d’éducation et de formation professionnelle seront vite attirés par des promesses de gains rapides illégaux, qu’ils proviennent du commerce des drogues, de la traite humaine ou du vol d’organes.
Dans son acte constitutif, l’UNESCO retient « qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité[3]». Que ce sont les luttes pour le pouvoir politique et économique qui sont à l’origine des conflits est une vérité de La Palice. Il faut toutefois relever qu’au XXe siècle, de nombreux États ont cherché et trouvé une certaine solidarité morale et intellectuelle quand ils se sont engagés pour définir les droits de l’enfant et pour leur donner des bases normatives.
Le Comité de protection de l’enfance de la Société des Nations
La Société des Nations, créée en 1919, instaure en 1924 le Comité de protection de l’enfance (CPE) (qui cessera ses activités en 1937). Ce comité est peu connu, mais significatif, puisqu’il est une des premières illustrations d’une approche transnationale, un concept novateur après une guerre qui avait confronté des blocs de nations. Dans les analyses du CPE, on retrouve certaines approches déjà amorcées au XIXe siècle, quoique plus éparpillées. « On assiste ainsi à l’apparition parallèle de réseaux axés sur la protection du nourrisson, tandis que d’autres sont spécialisés dans la question scolaire, la lutte contre la prostitution, ou encore l’enfance abandonnée ou délinquante. C’est au sein de ce dernier réseau qu’une première tentative de regroupement au niveau international va intervenir.[4] » Toutefois, une association internationale de protection de l’enfance créée en 1913 à Bruxelles voit ses activités à peine entamées interrompues par la guerre. Les millions d’orphelins et de réfugiés que la Grande Guerre a laissés suscitent de nouveaux élans d’entraide, fût-ce par la Croix-Rouge, le Save the Children Fund (créé en 1919), ou encore l’Union internationale de secours aux enfants (UISE, 1920), dont le siège est à Genève[5].
En 1921, des experts d’une trentaine de nations se retrouvent à Bruxelles pour raviver l’idée d’une association internationale de protection de l’enfance. La jeunesse de la Société des Nations et l’absence d’un concept de collaboration multilatérale – incarné plus tard par les Nations Unies – ont pour conséquence la coexistence de nombreux comités ou groupes de travail nationaux, avec des champs d’action bien spécifiques qu’ils comptent défendre. « L’Organisation internationale du travail s’occupe des jeunes travailleurs, la Société des Nations de la traite des femmes et des enfants, et des questions d’hygiène ; du côté des associations privées, l’UISE et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge se sont, quant à elles, arrogées le domaine de l’assistance humanitaire et sanitaire[6]. » Le congrès de Bruxelles aboutit bien à la création d’une Association internationale de protection de l’enfance (AIPE) qui compte s’engager contre la délinquance juvénile. Toutefois, elle est, dès ses débuts, affaiblie : elle n’admet pas les anciens Empires centraux et les États anglo-saxons qui, préférant la Croix-Rouge et l’UISE, s’opposent à son adhésion à la Société des Nations. Réduite à une association d’œuvres privées, l’AIPE perd son secrétariat général transféré de Bruxelles à Genève et intégré au Comité consultatif de protection de l’enfance. Les compétences de ce comité se concentreront peu à peu sur le domaine normatif, puisqu’il a mandat de préparer les décisions ad hoc de la Société des Nations. Tout au long de son existence, ce comité souffre de manque de moyens, tant financiers qu’humains et de tensions entre ses différents membres. En 1937, il sera transformé en Comité consultatif des questions sociales qui préfigurera le Comité économique et social des futures Nations Unies[7].
Déclarations, conventions, protocoles, comités…
La Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant[8] adoptée le 26 septembre 1924 par la Société des Nations est le premier texte international qui reconnaît les droits des enfants et les responsabilités des adultes à leur égard. Sachant qu’elle retient que « l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur »[9], il faut constater avec résignation que trop souvent elle donne à l’enfant ce qu’elle a de pire. La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 stipule que « [les enfants] ont droit à une aide et à une assistance spéciales »[10], une assistance confiée par les Nations Unies (qui reprennent la Déclaration de Genève de 1924) à l’UNICEF, créée en 1946 pour aider les enfants (européens) victimes de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1950, l’UNICEF étendra son action aux enfants défavorisés du monde entier.
Le 20 novembre 1959, les Nations Unies adoptent à l’unanimité la Déclaration des Droits de l’enfant qui réitère l’importance d’une éducation gratuite, de soins médicaux et de services sociaux appropriés et surtout d’un entourage lui garantissant « amour et […] compréhension » (principe 6)[11]. En 1966, deux pactes internationaux adoptés par les Nations Unies[12] complètent la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 : le Pacte international sur les Droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels[13]. Ces pactes corroborent les droits de l’enfant déjà retenus par les déclarations qui les ont précédées. La Convention 138 de l’Organisation internationale du travail, adoptée en 1973, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi (entre 15 et 18 ans)[14].
65 ans après la Déclaration de Genève, la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant (CIDE) de 1989 est « le premier texte international juridiquement contraignant de protection des Droits de l’Enfant […] [et] le texte le plus complet de protection des droits des enfants, [car il aborde] tous les aspects des droits des enfants »[15]. Dans ses 54 articles, la Convention précise les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les enfants en évoquant quatre principes de base : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi que le respect de l’opinion de l’enfant. Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, elle entre en vigueur moins d’un an plus tard, après sa ratification par 20 États. A ce jour (août 2024), la CIDE a été signée par tous les États membres des Nations Unies, à l’exception des États Unis[16].
Générant des marchés où les plus démunis produisent pour le profit des sociétés industrielles, la globalisation impose d’autres instruments normatifs dont les énoncés reflètent une évolution déplorable. La Convention de Genève sur les pires formes de travail des enfants, adoptée en 1999 par l’Organisation internationale du Travail[17], énumère ces pires formes de travail : esclavage, vente et traite des enfants, servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire ; recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; utilisation des enfants à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques ; utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, comme la production ou la vente de drogues. Cette convention est complétée en 2000 et en 2011 par trois protocoles facultatifs. L’application de ces textes est contrôlée par un Comité des droits de l’enfant.
Le Comité des droits de l’enfant est composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant par ses États parties. Il surveille également l’application des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention, qui portent sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Ces 30 dernières années, la vie des enfants a été transformée par cette Convention, qui est l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus largement ratifié de l’histoire. La Convention relative aux droits de l’enfant a incité les gouvernements à changer leurs lois et leurs politiques, pour que davantage d’enfants puissent accéder aux soins de santé et à la nutrition qui leur sont nécessaires. Il existe désormais de meilleures garanties pour protéger les enfants de la violence et de l’exploitation. Davantage d’enfants font entendre leurs voix et participent à la société. Il reste cependant encore beaucoup à faire[18].
… et tout reste à faire
« Le droit n’a de véritable effet que s’il est respecté ». (Comité international de la Croix-Rouge[19])
Toutes ces déclarations, conventions et protocoles témoignent des efforts entrepris depuis plus d’un siècle pour protéger les enfants afin de leur garantir une jeunesse à l’abri de menaces et de dangers. Toutefois, les dérives que connaissent les sociétés actuelles montrent aussi à quel point tous ces documents élaborés pendant de longues années et ratifiés après de plus longues années encore restent lettre morte.
Dans un communiqué du 5 juin 2023, l’UNICEF retient que « [plus de] 300 000 violations graves [ont été] commises à l’encontre des enfants en zones de conflit [dans le monde] au cours des 18 dernières années. […] Depuis 2005, au moins 120 000 enfants à travers le monde ont été tués ou mutilés en raison d’un conflit, soit une moyenne de près de 20 enfants par jour »[20]. Entre 2005 et 2022, plus de 120 000 enfants ont donc été tués et mutilés, au moins 105 000 recrutés par des forces ou groupes armés, 32 000 ont été enlevés et plus de 16 000 ont été victimes de violences sexuelles. 16 000 écoles et hôpitaux ont été attaqués et 22 000 enfants se sont vu refuser un accès à l’aide humanitaire[21].
Publié en 2023 dans le cadre de la Conférence d’Oslo sur la protection des enfants dans les conflits armés, ce communiqué ne peut pas tenir compte des conflits qui sont toujours en cours ni de la destruction de Gaza avec le bombardement ciblé de ses écoles et de ses hôpitaux. Les chiffres officiels ne peuvent évidemment que tenir compte des cas confirmés : le bilan est donc sans aucun doute beaucoup plus lourd.
Les textes, les débats, les communiqués et les chiffres ne reflètent pas la désolation dans laquelle les enfants dans une zone de conflit doivent grandir. Confrontés à une violence quotidienne, chassés de leur domicile, privés de leurs camarades et de leur quotidien rassurant, n’arrivant plus à dormir, voyant leurs proches tués, leurs logements détruits, souffrant de faim, de saleté, de violences et d’une peur constante, comment (sur)vivent-ils ? Quelle est l’utilité de textes qui garantissent leurs droits à la liberté, à l’éducation, à un entourage stable, à la nourriture, à l’eau potable, à un logement décent, quand tous ces droits sont bafoués devant leurs yeux ? Ce n’est certes pas une consolation de supposer qu’une grande partie de ces enfants ignorent qu’ils ont des droits.
Le droit d’aller à l’école est bafoué dans les zones de conflit
« Les enfants et les systèmes éducatifs sont souvent les premiers à subir les conséquences des conflits armés[22]. » Bien au-delà d’un cadre pour l’apprentissage de matières scolaires, une école est un creuset social : on y noue des relations amicales, on s’y confronte, on y joue, on y fait du sport, on apprend à connaître les valeurs inhérentes aux sciences, à la philosophie, la musique, l’art, la littérature. La scolarité – avec parfois ses aléas – est une phase importante dans la vie de chaque jeune, car elle lui permet de se mesurer à d’autres, elle lui fait connaître le bonheur d’un succès ou la tristesse d’un échec, des expériences indispensables à une vie d’adulte. Le cadre familier de la salle de classe, le chemin de l’école et la régularité d’un horaire contribuent à un rythme de vie sécurisant.
L’absence d’un tel cadre régulier, l’annulation de cours, des bâtiments scolaires détruits ou l’enlèvement de jeunes qui fréquentent des écoles sont malheureusement des phénomènes de plus en plus fréquents. Ils touchent les enfants en zones de conflit, mais aussi les quelque 50 millions de jeunes réfugiés qui, séparés de leurs parents et souvent de leurs cultures, restent dépourvus des moyens de se former et de s’instruire – avec les conséquences que l’on devine pour les sociétés futures.
Ces conséquences sont multiples : des enfants qui vivent dans un contexte de violence constante développent des traumatismes graves qui peuvent se manifester par un retrait émotionnel, une incapacité de nouer des relations normales, des comportements agressifs, mais aussi des automutilations, des abus de drogue ou encore des tentatives de suicide. Des centaines de milliers de jeunes qui n’ont connu que violence et agressivité, sans aucune aide psychologique, qui n’ont pas appris ne fût-ce que les bases des matières scolaires ou d’une formation professionnelle sont des victimes faciles pour tous les pièges que des adultes criminels et irresponsables leur tendent. Une éducation dans un cadre structuré – y compris, dans la mesure des possibilités, à l’intérieur d’une ville assiégée ou d’un camp de réfugiés – aiderait les jeunes à alléger leurs traumatismes et à partager leurs expériences. Elle rassurerait aussi leurs parents qui sauraient que leurs enfants sont protégés et qu’ils ont accès à des repas, de l’eau potable ou encore des toilettes. Comme il est affirmé sur le site de l’UNICEF :
Le droit d’un enfant à l’éducation ne peut pas être préservé dans les zones de conflit si l’éducation elle-même n’est pas protégée. L’éducation peut sauver des vies. Quand ils ne vont pas à l’école, les enfants sont particulièrement à la merci de la maltraitance, de l’exploitation et du recrutement par des forces ou des groupes armés. L’école devrait être un lieu sûr où les enfants sont à l’abri des menaces et des situations de crise. Cela constitue également une mesure essentielle pour rompre le cycle des crises et réduire le risque de conflits à l’avenir[23].
Mais, dans trop d’endroits, les écoles ne sont plus des lieux sûrs. Ainsi, le 13 mars 2024, l’ONU fait savoir qu’en Ukraine plus de 3 400 établissements scolaires ont été endommagés et 365 entièrement détruits depuis le début de l’agression russe.
Des données récentes indiquent qu’au moins 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays sont des enfants, dont environ 225 000 sont en âge d’être scolarisés. Environ trois enfants sur quatre ont été les témoins directs des bombardements et des tirs d’artillerie. Les enseignants ont également été touchés, puisqu’on estime à 43 000 le nombre d’enseignants déplacés par le conflit.[24]
L’ONU estime que dans la bande de Gaza, 80 % des bâtiments scolaires (abritant quelque 228 000 élèves et plus de 8 500 enseignants) ont été touchés par des attaques ciblés. Ces attaques – motivées par la supposition que les écoles servent de refuge aux terroristes du Hamas – ont encore aggravé une situation pédagogique très fragilisée par un long blocus[25].
Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir n’existe que sur le papier
« D’après l’UNICEF, plus de 230 millions d’enfants (soit près d’un enfant sur dix dans le monde) vivent dans des pays ou des zones qui connaissent des conflits armés. 125 millions d’entre eux sont directement affectés par les combats dans le monde. L’ONU a vérifié 266 000 cas de violations graves à l’encontre d’enfants dans plus de 30 situations de conflit depuis l’instauration du mécanisme de suivi en 2005 »[26].
Exposés aux bruits et aux horreurs des combats et particulièrement vulnérables au recrutement comme enfants soldats – un terme qui ne désigne pas uniquement des combattants actifs.
« Un enfant associé à une force armée ou un groupe armé » est toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce Il peut s’agir notamment, mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités[27].
A la fin des années 1990, Amnesty International, Human Rights Watch, Terre des Hommes, Jesuit Refugee Service, le Quaker United Nations Office (Genève) et Save the Children relancent la discussion autour d’une interdiction de recruter des jeunes de moins de 18 ans dans les armées – l’âge minimum en vigueur dans certaines armées étant de 15 ans à cette époque. Cette politique du « straight 18 » aboutit en 2000 à l’adoption du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Dans son article 2, le Protocole stipule que « les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées », tandis que l’article 4 exprime un souhait peu réaliste : « Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans »[28].
Dans leur Agenda 2030, les Nations Unies avaient retenu comme premier objectif de développement durable de « vouloir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde »[29]. Or, les conditions de vie précaires dans des mégalopoles, dont des quartiers entiers sont dirigés par des groupes mafieux, et l’absence de structures de soutien ou de cadre familial rassurant ne font qu’accroître la vulnérabilité de jeunes qui sont dès lors tentés de chercher (et parfois de trouver) dans les groupes armés une forme de protection, sinon de statut social. D’autres y sont intégrés de façon forcée : leur enlèvement déstabilise et fragilise leurs familles et leurs villages, sapant ainsi un équilibre social déjà précaire :
Les enfants sont recrutés dans les forces ou les groupes armés parce qu’ils sont considérés comme faciles à manipuler, parce qu’ils ne sont pas vraiment conscients des dangers encourus et qu’ils n’ont pas encore la notion du bien et du mal. Dans certains cas, on leur fournit des armes meurtrières, on leur fait boire de l’alcool et on les drogue pour les inciter à la violence et leur enlever toute peur, ou on les contraint à devenir dépendants du groupe qui les a recrutés. Incapables de trouver une issue ou trop effrayés pour le faire, ces enfants deviennent parfois incontrôlables et dangereux à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Cependant, les enfants associés à des forces ou à des groupes armés souffrent de séquelles physiques, psychologiques et sociales : les effets de leur participation au conflit perdurent souvent longtemps après la fin des hostilités[30].
La situation est particulièrement préoccupante en Afrique où près de 40 % des habitants ont moins de 15 ans. Dans un rapport de 2022[31], les Nations Unies retiennent que les pays d’Afrique centrale et occidentale sont un nouvel épicentre du recrutement d’enfants soldats, notamment en raison de la résurgence des mouvements militants islamistes. Au-delà du Sahel, la situation est particulièrement préoccupante au Soudan du Sud. En 2005, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a instauré par sa résolution 1612 un mécanisme de surveillance, de communication sur le recrutement des enfants-soldats[32]. Des comités nationaux analysent la situation dans les pays respectifs (lieux de recrutements, groupes responsables, méthodes d’exploitation) et transmettent leurs rapports au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de conflit armé.
Toutefois, ces analyses et ces rapports ne suffisent pas : il faut aussi insister encore et toujours sur le fait (souvent ignoré à dessein) que le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé est un crime de guerre[33]. Mais, nous le savons, là où il n’y a pas de plaignant, il n’y a pas d’accusé.
Il ne faut cependant pas baisser les bras devant des situations qui selon les régions deviennent de plus en plus graves. Les grandes organisations multinationales et multilatérales, les innombrables ONG qui travaillent avec engagement sur le terrain, les instruments normatifs destinés à protéger les enfants et à leur garantir une jeunesse sereine sont des réalités. Ils doivent réussir à convaincre les gouvernements et les groupes armés qui recrutent des enfants que l’avenir et le bien-être moral des sociétés reposent sur des enfants qui ont la chance de grandir sans violence et sans faim, entourés par des familles aimantes et pouvant accéder à des formations scolaires dignes de ce nom. Il faut aussi condamner clairement les gouvernements qui bombardent des écoles et des hôpitaux, enlevant ainsi aux enfants et aux jeunes les possibilités de se construire un avenir et de soigner leurs blessures.
Le droit à l’alimentation est démenti par les chiffres
« Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné »[34].
Jean Ziegler
L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 retient que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. […] La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales »[35]. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté en 1966 par les Nations Unies et ratifié par 172 États[36] reconnaît dans son article 11.2 « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim »[37], lui donnant une valeur contraignante pour tous les États signataires.
En 2001, le premier Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, définit ce droit comme « droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne »[38].
Cet accès libre et régulier à l’alimentation n’est pas assuré dans un grand nombre de régions. Conflits régionaux, guerres, déforestation, changement climatique, effets de la globalisation, usage abusif de ressources naturelles sont autant de causes pour les chiffres alarmants du début des années 2020. En Afghanistan, 4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, au Yémen 2,2 millions d’enfants meurent de faim, un million au Kenya, presque deux millions en Somalie, en République démocratique du Congo 1,1 million d’enfants n’atteignent pas leur cinquième année. Le 9 juillet 2024, les Nations Unies annoncent dans un communiqué de presse que, d’après des experts indépendants envoyés sur place, « la famine s’étend à toute la bande de Gaza » :
Fayez Ataya, âgé d’à peine 6 mois, est décédé le 30 mai 2024 et Abdulqader Al-Serhi, 13 ans, est mort le 1er juin 2024 à l’hôpital Al-Aqsa de Deir Al-Balah. Ahmad Abu Reida, 9 ans, est mort le 3 juin 2024 dans la tente abritant sa famille déplacée à Al-Mawasi, à Khan Younès. Ces trois enfants sont morts de malnutrition et d’un manque d’accès à des soins de santé adéquats […]. Au vu du décès de ces enfants, morts de faim en dépit du traitement médical qu’ils avaient reçu dans le centre de Gaza, il ne fait aucun doute que la famine s’est propagée du nord de Gaza au centre et au sud de Gaza[39].
En guise de conclusion : chassons les ténèbres du berceau !
Spoliés d’un cadre de vie qui n’est pas en ruine, d’un parent cher qui a été tué, d’une cour d’école où ils pourraient retrouver leurs amis, de nuits de sommeil ininterrompues, souffrant de faim, de soif, de maladies, de violences sexuelles, des millions d’enfants dans le monde sont privés des droits humains les plus élémentaires. Dépossédés de leur droit d’aller à l’école, de manger à leur faim sans devoir voler ou se prostituer, entourés par le bruit constant des attaques aériennes ou par le silence d’un désert qui ne cesse de s’étendre, ils grandiront traumatisés, ayant perdu tous les repères qui font qu’une société évolue. Malades de corps et d’esprit, souvent sans parents, leur peur et leur solitude doivent être infinies.
De nombreux traités, pactes, conventions, conférences, protocoles sont consacrés depuis longtemps à l’amélioration du sort des enfants, mais on ne peut que constater leur manque d’efficacité. Convaincues toutefois que le dialogue doit toujours primer, que tout échange permet des rapprochements, qu’il ne faut pas baisser les bras, les grandes organisations multinationales et les ONG continuent leur lutte pour les plus démunis dont on vole l’enfance.
Donnons le mot de la fin à Victor Hugo, qui le 22 septembre 1862 s’adressait aux membres du Congrès international des sciences sociales : « L’enfant a dans son berceau la paix ou la guerre de l’avenir. C’est de ce berceau qu’il faut chasser les ténèbres. Faisons lever l’aurore dans l’enfance »[40].
[1] Save the Children, « World more dangerous than ever for children with crimes in conflict at highest level in 2023 » [traduit de l’anglais], communiqué de presse, 31 octobre 2024, https://www.savethechildren.net/news/world-more-dangerous-ever-children-crimes-conflict-highest-level-2023.
[2] « Les enfants dans les conflits », UNICEF, https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/urgences/conflits-armes/enfants-et-conflits/.
[3] « Acte constitutif », UNESCO, https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/constitution.
[4] Joëlle Droux, « La tectonique des causes humanitaires : Concurrences et collaborations autour du Comité de protection de l’enfance de la Société des Nations (1880-1940) », Relations internationales 3, n° 151 (2013) : 79-80.
[5] Joëlle Droux, « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925) », Critique internationale 3, n° 52 (2011) : 19-23.
[6] Droux, « La tectonique », 80.
[7] Droux, « L’internationalisation », 26-32.
[8] Société des Nations, Déclaration de Genève des droits de l’enfant (1924), https://www.humanium.org/fr/texte-integral-declaration-de-geneve/#:~:text=L’enfant%20qui%20a%20faim,doivent%20être%20recueillis%20et%20secourus.
[9] Société des Nations, Déclaration de Genève des droits de l’enfant.
[10] AG Rés. 217 (III) A, Déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948).
[11] AG Rés. 1386(XIV), Déclaration des droits de l’enfant (20 novembre 1959).
[12] AG Rés. 2200A (XXI), Pacte international sur les Droits civils et politiques et Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966).
[13] Signés par le Luxembourg le 26 novembre 1974, ces pactes ont été ratifiés le 18 août 1983.
[14] Organisation internationale du travail, Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 26 juin 1973, n° 138, UNTS 14862.
[15] « Convention des droits de l’enfant : Présentation de la Convention internationale des droits de l’enfant », Humanium, https://www.humanium.org/fr/convention/.
[16] Signée le 21 mars 1990 par le Luxembourg, la CIDE est ratifiée par la Chambre des Députés le 7 mars 1994.
[17] Organisation internationale du Travail, Convention sur les pires formes de travail des enfants, 17 juin 1999, n° 182, UNTS 2133, 161.
[18] « Organes conventionnels : Comité des droits de l’enfant », Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crc.
[19] Comité international de la Croix-Rouge, Enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés (2013), 5.
[20] UNESCO, « 300 000 violations graves commises à l’encontre des enfants en zones de conflit au cours des 18 dernières années », communiqué de presse, 5 juin 2023, https://www.unicef.fr/article/300-000-violations-graves-commises-a-lencontre-des-enfants-en-zones-de-conflit-au-cours-des-18-dernieres-annees/.
[21] UNESCO, « Violations graves ».
[22] Équipe du Rapport mondial de suivi sur l’éducation, La Crise cachée : les conflits armés et l’éducation (UNESCO, 2011) https://doi.org/10.54676/RAAO5850.
[23] « L’éducation prise pour cible », UNICEF, https://www.unicef.org/fr/education-prise-pour-cible.
[24] ONU Info, « Guerre en Ukraine : plus de 3.500 établissements d’enseignement endommagés ou détruits », communiqueé de presse, 13 mars 2024, https://news.un.org/fr/story/2024/03/1144001.
[25] ONU Info, « Gaza : plus de 200 écoles directement touchées depuis le début de l’opération militaire israélienne, selon l’ONU », communiqué de presse, 27 mars 2024, https://news.un.org/fr/story/2024/03/1144396.
[26] « Les enfants dans les conflits armés », Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York, 18 mars 2022, https://onu.delegfrance.org/les-enfants-dans-les-conflits-armes-10456.
[27] UNICEF, Principes de Paris, Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Assemblée Générale des Nations Unies, 2007). Définition également reprise par le Comité international de la Croix-Rouge.
[28] AG Rés. 54/263, Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, articles 2 et 4.
[29] « Développement durable objectif 1 », Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, https://sdgs.un.org/fr/goals/goal1.
[30] Comité international de la Croix-Rouge, Enfants associés, 4.
[31] Secrétaire général des Nations Unies, Les enfants et les conflits armés, UN doc. A/76/871–S/2022/493 (23 juin 2022).
[32] SC Rés. 1612 (26 juillet 2005).
[33] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8, ¶ 2(b)xxvi, UN doc. A/CONF.183/9 (17 juillet 1998) .
[34] Jean Ziegler, Destruction massive. Géopolitique de la faim (Editions Le Seuil, 2011).
[35] AG Rés. 217 (III) A, art. 25.
[36] Ratification par le Luxembourg le 18 août 1983.
[37] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11, ¶2, 16 décembre 1966, UNTS 14531.
[38] Conseil économique et social des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, 2, UN doc. E/CN.4/2001/53 (7 février 2001).
[39] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Des experts de l’ONU déclarent que la famine s’étend à toute la bande de Gaza », communiqué de presse de l’ONU, 9 juillet 2024, https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2024/07/un-experts-declare-famine-has-spread-throughout-gaza-strip.
[40] Lettre de Victor Hugo sur l’enseignement obligatoire. La lettre fut lue à Bruxelles lors de la séance du 23 septembre 1862 de l’Association internationale pour le progrès des sciences sociales et éditée dans Le Progrès. Journal de l’éducation populaire, n° 32 (4 octobre 1863) : cxxvi.

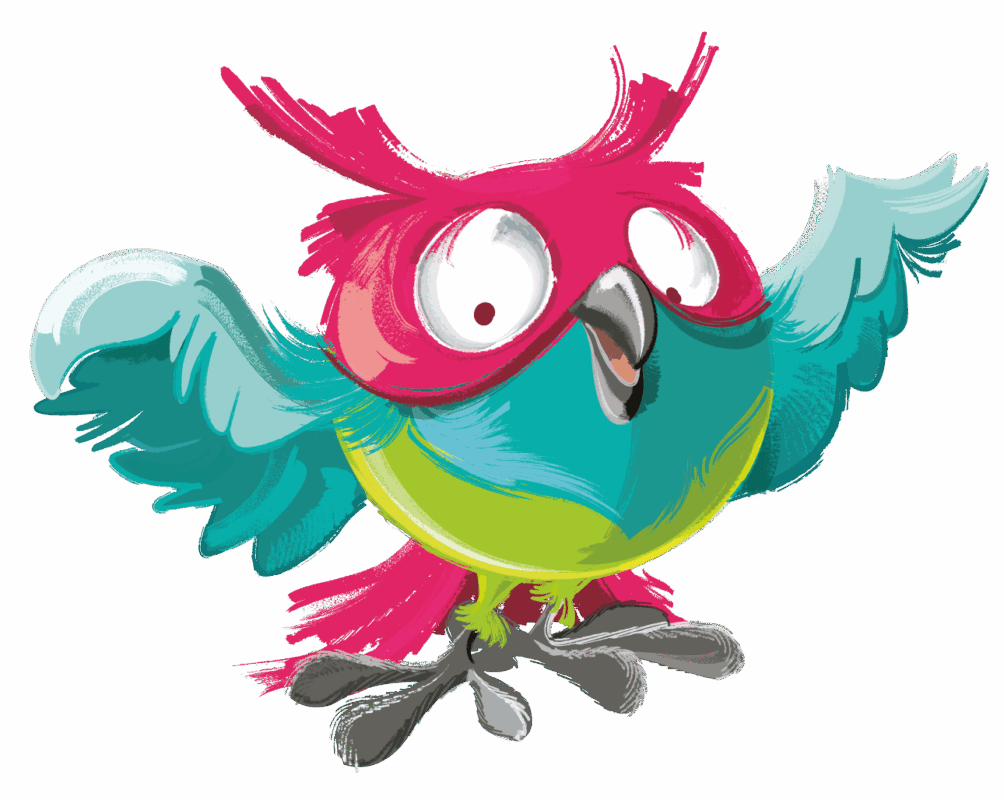
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Maison des Droits de l’homme
65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Les enfants en zone de conflit : rêves et réalités
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.